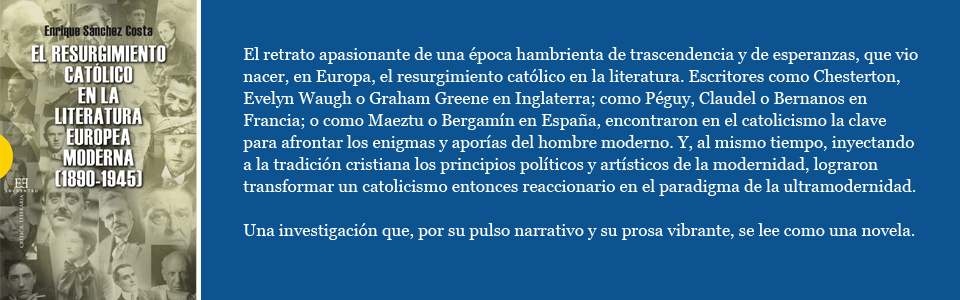Inicio » Hacia un nuevo catolicismo
Archivo de la categoría: Hacia un nuevo catolicismo
Lo temporal y lo espiritual (Péguy)
Charles Péguy en su tienda de Cahiers de la Quinzaine, en 1913
Charles Péguy: «Véronique: Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle» (1914)
(Póstumo. En Péguy: Œuvres en prose, 1909-1914. París: Gallimard, 1957, pp. 845-1023. Fragmentos)
… de cet étonnement qui est à l’origine, au point d’origine, à la naissance même, au principe, […], á la racine (et de la science), et de la création même, et de l’adoration, et de la petite et si grande sœur, de l’admiration, de la si précieuse faculté d’admiration. […]
L’âge temporel des éternels mêmes, l’insertion temporelle de l’éternel par (cette) coïncidence, par cette sorte de collusion ; par cette liaison, étroite, plus qu’une connexion, par cette coexistence, par cette sorte de consubstantialité, de coessentialité. Temporaire. La racination, le racinement de l’éternel par la race et dans le peuple. Dans le temps. […]
Il y a beaucoup d’impiété dans leur ignorance du siècle (temporel) ; dans cette ignorance, plus ou moins volontaire, plus ou moins involontaire ; plus ou moins inconsciente, mais généralement très consciente ; dans ce mépris plus ou moins affecté ; beaucoup d’orgueil sans aucun doute et beaucoup de paresse ; que sont deux péchés capitaux ; mais, ce qui est (beaucoup) plus grave, en un sens infiniment plus grave, beaucoup d’impiété ; peut-être en un sens infiniment d’impiété ; beaucoup de méconnaissance d’une partie non pas essentielle, mais contreessentielle, juxteessentielle, indispensable, complémentaire indispensable, nullement supplémentaire ; ainsi infiniment de mécannaissance de ce qu’est la création, de ce qui fait la création même, de ce goût qu’elle a, de ce goût propre, de cette saveur sur la langue. […]
L’idée de derrière la tête de tous ces clercs, et de ceux qui vivent dans la règle, et même de ceux qui vivent dans le siècle […] c’est que le bon Dieu a créé toute sa création, celle-ci, où nous sommes créatures […] non pas seulement à faux, ce qui se soutiendrait, mais à vide, ce qui alors ne se soutient plus du tout, […] que Dieu aurait créé le monde à blanc […], que la création, que le monde serait un coup tiré à blanc. […]
Ils [les clercs] ont perdu ce peuple qui leur était commis. D’un peuple qui était si profondément chrétien, comme cela se voit de toutes parts, si intérieurement, chrétien dans le cœur et dans l’âme, dans la chair et dans le sang, non, comment ils ont bien pu s’y pendre pour (en) faire ce peuple si profondément, si réellement inchrétien […] voilà, mon mai, voilà le problème. […]
… que toute cette déchristianisation, que toute la déchristianisation est venue du clergé. Tout le dépérissement du tronc, le desséchement de la cité spirituelle, fondée temporellement, fondée, promise éternellement, ne vient point des laïques, elle vient des clercs. Procedit a clericis. […] Il vient d’un dépérissement, d’un desséchement, d’une désaffection, d’une disgrâce, d’une stérilité (de grâce), d’une insuffisance, d’une incurie, d’une impéritie, d’une déficience des clercs. Ils ont ainsi fait ce désastre spirituel, temporairement si contraire aux promesses. Moyennant quoi, pour se rassurer, pour se masquer ces responsabilités effrayantes, pour se dérober, soi, eux et ces responsabilités, à soi, à eux-mêmes, au monde, à Dieu, faibles ils mentent, lâches ils nient, ils masquent, ils aveuglent, pieux els oublient (dans la prière et dans les sacrements), faussement, obscurément, clairement, sournoisement ils démentent le désastre ; ils nient le désastre mystique ; mais ce désastre mystique est tel, et temporairement si contraire aux promesses qu’il ne peut s’expliquer, rationnellement, mystiquement, ce désastre mystique et ce renversement mystique ne se peut expliquer, rationnellement, mystiquement, que par une faute de mystique, une faute pour ainsi dire de technique de la mystique, une faute capitale, une faute équivalente de mystique. […]
Là est exactement le défaut historique, le défaut rationnel et le défaut mystique, le défaut mystique de la technique de la mystique. L’éternel a été provisoirement masqué ; l’éternité a avorté dans le temps (pour quel temps) ; l’éternel a avorté temporellement, (temporairement) ; l’éternel a été temporairement suspendu parce que les chargés de pouvoir, les fondés de pouvoir de l’éternel ont méconnu, ont inconnu, ont oublié ; ont méprisé le temporel. Ils m’ont méconnue, simplement, moi la séculaire et la séculière, et un grand malheur est venu dans le monde. […]
L’opération mystique a été totalement renversée. Le siècle n’a point fait son office, d’être même temporellement sauvé, parce que la règle n’a point fait son office dans le siècle. Et la règle n’a point vaincu le siècle, la règle n’a point pénétré dans le siècle, la règle n’a point sauvé temporellement le siècle parce que la règle a historiquement méconnu, inconnu, ignoré le siècle. Je dis historiquement, non point originairement, régulièrement, fondamentalement. Jésus était venu pour fonder, pour sauver (tout) le monde. Il n’était point séculier, ni régulier. […]
Mais essentiellement l’opération mystique alors, l’opération chrétienne originaire était une opération qui allait vers le siècle et non point une opération qui en revenait. Le siècle était incontestablement l’objet. la règle, ce qui est devenu la règle, était la matière et la nourriture, la matière dont était faite, la matière d’où venait la nourriture. […] De même que l’opération de la culture, j’entends de la culture antique, est essentiellement aussi une opération de nourriture, nullement une opération d’enregistrement ; une opération de nourriture de l’homme et du citoyen par les textes et par les autres monuments de l’antiquité. Ainsi l’opération mystique, l’opération chrétienne est essentiellement aussi une opération de nourriture, mystique, nullement une opération d’enregistrement, scientifique, historique ; une opération de nourrissement, de nutrition, de nourriture de l’homme et du chrétien par la parole et par le corps, par la chair et par la sang. Cette alimentation physique, cette alimentation mystique n’était nullement faite contre le siècle. Au contraire, elle allait au siècle.
Jésus n’était pas venu pour dominer le monde. Il était venu pour sauver le monde. C’est un tout autre objet, une toute autre opération. Et il n’était pas venu pour se séparer, pour se retirer du monde. […]
La vie de famille est au contraire la vie la plus engagée dans le monde, incomparablement, qu’il y ait dans le monde. Il n’y a qu’un aventurier au monde, et cela se voit très notamment dans le monde moderne : c’est le père de famille. Les autres, les pires aventuriers ne sont rien, ne le sont aucunement en comparaison de lui. Ils ne courent absolument aucun danger en comparaison de lui. Tout dans le monde moderne, et même et surtout le mépris, est organisé […] contre l’homme qui a cette audace, avoir femme et enfants, contre l’home qui ose fonder une famille. […] Car les autres, au maximum, n’y sont engagés que de la tête, ce qui n’est rien. Lui au contraire il y est engagé de tous ses membres. Les autres, au maximum, ne jouent que leur tête, et ce n’est rien. Lui au contraire il joue tous les membres. Les autres ne souffrent qu’eux-mêmes. […]
Par cette famille, par sa race, par sa descendance, par ces enfants il est engagé de toutes parts dans la cité future, dans le développement ultérieur, dans tout le temporel événement de la cité. Il joue la race, il joue le peuple, il joue la société, il met la société. Il joue (toute) la cité, présent, passé, avenir. Tel est son enjeu. Les autres se faufilent toujours. Ils n’ont à passer que de la tête. […] Rien de ce qui se passe, rien d’historique ne leur est indifférent. Ils souffrent de tout. Ils souffrent de partout. Eux seuls ont épuisé, peuvent se vanter d’avoir épuisé la souffrance temporelle, ce que je puis apporter de deuil à celui qui vit dans le temps. Celui qui n’a pas eu un enfant malade ne sait pas ce que c’est que la maladie. Celui qui n’a pas perdu un enfant, qui n’a pas eu, qui n’a pas vu son enfant mort ne sait pas ce que c’est que le deuil. Et il ne sait pas ce que c’est que la mort. […]
Ce que nous retiendrons premièrement, c’est que de l’enfant Jésus à l’homme Jésus a pris, c’est qu’il a gardé, de toutes les vies du monde, la vie la plus engagée dans le monde, nullement une vie de règle, une vie régulière, mais une vie de siècle, une vie séculière, et la plus engagée qu’il puisse y avoir dans le siècle. Tout autre est naturellement sa vie publique, les trois autres années. […]
J’y cherche en vain, mon ami, la règle, ce qui ultérieurement devait devenir la règle, vous n’y trouveriez pas l’origine et la trace du commencement de la règle. Je n’y vois pas l’ombre de la règle, l’ombre de la trace du commencement de la règle. Je n’y vois pas la fondation d’une règle, d’aucune règle. J’y vois dans la siècle, dans la matière du siècle, dans et vers le siècle, dans et vers la matière du siècle, une fondation, mais une toute autre fondation ; la fondation d’une cité, dans le siècle même, dont le siècle était la matière, et le prix, la fondation d’une cité mystique, dans le siècle, travaillant le siècle pour l’éternité, travaillant cette matière, formant pour l’éternité cette matière du siècle, enfin la fondation de la cité de Dieu, de la cité éternelle, de la cité éternelle de Dieu. […]
Une source mystique, une source d’amour, une source de vie, une source de grâce, pendant ces trois années une source éternelle, vers les sables du siècle une source qui n’était point venue du monde, une source mystique temporairement sur le monde vers le siècle débordante coula. […]
Ainsi nous naviguons constamment entre deux rués, nous manœuvrons entre deux bandes de curés ; les curés laïques et les curés ecclésiastiques ; les curés cléricaux anticléricaux, et les curés cléricaux cléricaux ; les curés laïques qui nient l’éternel du temporel, qui veulent défaire, démonter le temporel de l’éternel, de dedans l’éternel. Ainsi les uns et les autres ne sont point chrétiens, puisque la technique même du christianisme, la technique et le mécanisme de sa mystique, de la mystique chrétienne, c’est cela ; c’est un engagement d’une pièce, de mécanisme, dans une autre ; c’est cet emboîtement des deux pièces, cet engagement singulier ; mutuel ; unique ; réciproque, indéfaisable : indémontable ; de l’un dans l’autre et de l’autre dans l’un ; du temporel dans l’éternel, et (mais surtout, ce qui est nié le plus souvent), de l’éternel dans le temporel. […]
Nier l’éternel, mon ami, mon ami, mon enfant, et tout fonder sur moi pauvresse, mon pauvre enfant c’est si grossier qu’on est averti, prévenu, vacciné contre une aussi grossière opération. Mais nier au contraire la temporalité, la matière, la grossièreté, précisément, l’impureté, me nier, me renier moi la temporelle, voilà au contraire qui est le fin du fin, le pur et la pureté, le sublime pur. Voilà le plus grave, l’infiniment grave et la tentation des grandes âmes. C’est très précisément ce qui le dispute au chrétien. […]
Un Dieu, mon ami, Dieu s’est dérangé, Dieu s’est sacrifié pour moi. Voilà du christianisme. […] Le dernier des pécheurs, le plus infime des péchés fait à Jésus une blessure, et une blessure éternelle. Voilà du christianisme. Et moi l’histoire dans ma longue histoire je ne fais rien, je ne commets rien qui n’intéresse comme physiquement, comme naturellement Jésus, Dieu. Je ne commets temporellement rien qui ne s’insère comme physiquement dans le corps même de Dieu. Voilà mon ami, voilà du christianisme. Voilà du christianisme. Et du vrai. Le reste, mon ami, tout le reste, eh bien, allons, allons, mon cher Alphandéry, nous dirons que tout le reste est très bon pour l’histoire des religions. C’est cette ligature, éternelle, temporelle, plus que cette ligature, cet assemblement parfait, cette inversion, cette incrustation de l’un dans l’autre ; comme cette incrucification de l’un dans l’autre ; qui fait le christianisme. […]
Une des deux moitiés est infinie, et en elle-même et comme éternelle. L’autre des deux moitiés est infime, n’est pas moins nécessaire, moins indispensable à l’ensemble, au jeu de l’ensemble, que la partie qui est infinie, étant justement, précisément, par un retournement singulier, nécessaire, indispensable elle-même à cette partie infinie, au jeu de cette partie infinie. Ainsi nier l’une ou l’autre partie, c’est également nier le tout, démonter le merveilleux appareil. Un Dieu homme. Un homme Dieu. Mais nier le ciel n’est presque certainement pas dangereux. C’est une hérésie sans avenir. C’est si évidemment grossier. Nier la terre au contraire est tentant. D’abord, c’est distingué. Ce qui est le pire. C’est donc là l’hérésie dangereuse, l’hérésie avec avenir. […] L’homme, dit Pascal, l’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête. Il faut entendre cette pensée, il faut lire ce texte, comme tout les grands textes, dans son mot à mot même, dans sa plus grande, dans sa plus extrême littéralité. […] Le malheur est double. Le malheur est aussi que qui veut faire la bête fait la bête. Qui veut faire la bête y réussit généralement parfaitement. […]
Quand il veut monter, il descend, et quand il veut descendre, il descend aussi . […]
L’homme, l’humanité, l’homme demeure donc bien le théâtre, la résidence, le siège, le lieu d’élection d’une histoire singulière, unique, d’une histoire extraordinaire, invraisemblable, impossible : arrivée ; donc une matière unique, une matière d’élection, le siège d’une aventure, d’une histoire unique. Voilà le christianisme, mon ami, le centre et le nœud, l’axe et le gond, l’articulation maîtresse du christianisme. Un homme Dieu, un Dieu homme. […]
Le chrétien est profondément humain ; il est même, absolument, tout ce qu’il y a de plus humain, de plus profondément humain. Puisqu’il est le seul qui ait mis l’humanité au prix de Dieu. L’homme, le dernier des pauvres, le plus misérable des pécheurs, au prix même de Dieu. […]
Mais en un certain sens le pécheur ne demeure pas moins à cet étage que le saint, moins également ; il n’entre pas moins que lui dans le système ; il ne joue pas moins que lui, comme pièce, pas moins également ; il n’est pas une pièce moins essentielle, moins également ; il n’est pas une pièce moins essentielle, moins également essentielle ; il n’est pas moins littéralement un chrétien, également littéralement, que le saint. Là est l’axe. Pas plus non plus, pas plus, pas plus. Également, ou plutôt ensemble. Communément. Communautairement. En commun. En communauté. En communion. […]
C’est une religion mystique. C’est la religion du salut. Ces grands perfectionneurs, ces renchérisseurs, ces amateurs en somme, ces partisans, ces artisans de surenchères, qui veulent améliorer le christianisme, pourraient bien n’être en définitive que des hommes, que des gens de trop (de) bonne volonté, des zélateurs, ils pourraient bien n’être en définitive que des tenants de la religion du progrès. En dernière analyse. Ils ne sont ainsi plus, ils ne sont que des chrétiens décentrés, des chrétiens désaxés, des chrétiens décalés. […] Il ne s’agit de perfectionner. Il s’agit de tenir, de garder le point fixe. […] Le point fixe du christianisme est qu’il y a un certain étage propre, un étage particulier, une résidence où demeurent également le pécheur et le saint. Tous deux également en un certain sens ils font partie, intégrante et intégrale, du même système, plus que du même système, de la même cité ; ils sont concitoyens de la même cité de Dieu, mon ami, de la même cité éternelle ; de la même cité éternelle temporellement fondée. […]
C’est qu’il y a un monde moderne et que ce monde moderne n’est pas seulement un mauvais monde chrétien, un monde mauvais chrétien, ce ne serait rien, censément, mais un monde inchrétien, déchristianisé, absolument, littéralement, totalement inchrétien. […] Mais quand on parle de (la) déchristianisation, quand on dit qu’il y a un monde moderne et qu’il est parfaitement déchristianisé, totalement inchrétien, on veut dire exactement qu’il a renoncé à tout le système, d’ensemble, qu’il se meut entièrement en dehors du système, on ne veut pas moins dire que le renoncement de tout le monde à tout le christianisme. Et la constitution d’un tout autre système, infiniment autre, nouveau, libre, entièrement, absolument indépendant. […]
Nous avons vu se constituer sous nos yeux, sinon se fonder, nous avons vu s’instituer, vivre, s’asseoir, s’établir, fonctionner un monde, une société, je ne dis pas une cité, parfaitement viable et entièrement inchrétienne. […]
Que vous-mêmes vous êtes les premiers qui […] avez réussi à faire un monde, et un monde prospère, sans Jésus, toute une société, et une société prospère, sans Jésus ; un monde, une société, prospères, inchrétiennes après Jésus. […] Que ne feraient-ils pas, les catholiques et au milieu d’eux les clercs, le contingent des clercs, que ne feraient-ils pas pour se masquer, pour se dérober la vérité, la réalité, pour ne pas s’avouer la vérité, la réalité, pour ne pas faire leur mea culpa, eux qui l’on tant fait faire aux autres. […]
Il n’incrimina, il n’accusa personne. Il sauva.
Il n’incrimina pas le monde. Il sauva le monde.
Eux (autres) ils vitupèrent, ils ratiocinent, ils incriminent. Injurieux médecins, qui s’en prennent au malade. Ils accusent les sables du siècle, mais du temps de Jésus il y avait aussi le siècle et les sables du siècle. Mais sur le sable aride, sur le sable du siècle une source, une source de grâce intarissable coulait.
Ah non, ils n’imitent pas Jésus. […]
Ce monde dont ils sont comptables, ce monde qu’ils ont perdu, quand ils veulent l’incriminer, alors ils le nomment le siècle, (c’est un anabaptême, une sorte d’anabaptême), et alors ils s’y mettent, ils commencent, ils se mettent à l’incriminer. […]
L’excommunié n’est point exchristianisé. Il n’est point déchristianisé, inchristianisé. Il ne peut même point l’être, puisqu’il est toujours soumis aux pénalités chrétiennes. […]
Le pécheur, (l’excommunié) est dans le christianisme, il est du christianisme, du système chrétien. L’inchrétien (l’antique, le moderne, le juxtachrétien) n’est pas, n’est aucunement du christianisme, du système chrétien. Là est la nouveauté, là est la gravité (l’antiquité, la modernité, toujours la nouveauté). […]
Il y a que le monde moderne est un monde inchrétien et qui a parfaitement réussi à se passer du christianisme. […]
Mais il faut entendre dans sa plus grande rigueur, dans sa plus grande littéralité, cette indication de Pascal : Qui veut faire l’ange. Vos saints, comment vos saints, le premier de vos saints, (aliorum sanctorum) l’a senti. Saint Louis à Tunnis ; Jeanne d’Arc à Rouen ; (et) Jésus au mont des Olives. Le sain sur son lit de mort ; la sainte sur le bûcher, sur son bûcher de mort ; le Christ au mont des Oliviers. […]
Cette anxiété terrible, la pire de toutes, le pire vertige, l’anxiété métaphysique, l’anxiété religieuse, qui nous serrait le ventre, qui nous étreignait les entrailles, qui nous poignait au creux des entrailles du ventre, cette anxiété en est diminuée, elle en reçoit un certain adoucissent. Alors nous sommes disposés à bien considérer, à regarder d’un œil assez favorable cette agonie tragique. Nous avons un courage, très particulier, un de ceux qui nous supportons courageusement les souffrances des autres. Par un effet, par une manifestation maxima de ce courage nous supportons avec un courage inlassable les souffrances de Jésus-Christ, les souffrances elles-mêmes maxima, infinies de Jésus. […]
Et lui-même il attendait. Car il était la clef de voûte. Et avant et après ensemble, dedans les siècles éternels attendaient. […]
S’il n’avait pas eu ce corps, mon ami, s’il avait été, s’il était resté un pur esprit plus ou moins pur, plus ou moins incharnel, s’il n’avait point été l’âme charnelle enfin, s’il ne s’était point fait cette âme charnelle, une âme charnelle, comme nous, comme les nôtres, parmi nous, parmi les nôtres, s’il n’avait point souffert cette mort charnelle, comme nous, comme les nôtres, parmi nous, parmi les nôtres, s’il n’avait point souffert cette mort charnelle, tout tombait, mon enfant, tout le système tombait ; tout le christianisme tombait ; car il n’était point homme tout à fait. Il n’était point réellement homme, homme jusqu’au bout ; ignorant, n’éprouvant pas, refusant d’éprouver la plus grande terreur de l’homme, la plus grande détresse de l’homme. Il n’était pas homme. Donc il n’était pas l’homme Dieu : Jésus ; le Juif Jésus. […]
Le chrétien, le christianisme, la chrétienté, la christianisation, l’événement chrétien, l’opération chrétienne est une opération moléculaire, intérieure, histologique, un événement moléculaire, qui a souvent laissé intactes les écorces de l’événement. Après comme avant il y a eu autant de crimes, sinon plus, hélas, et l’on vous a fait presque par trop bonne mesure. […]
Or le christianisme n’est point fait pour ceux qui veulent avoir des preuves. Aucunement. Il est même au contraire. Il est fait pour le contraire. Il est fait pour ceux qui veulent avoir des épreuves. […]
Vous avez éternisé, vous avez infinisé tout. Vous avez aussi infinisé cela. Vous avez omplètement chambardé le marché des valeurs. Vous avez tout porté, toutes les valeurs au maximum, à la limite, à l’éternel, à l’infini. Alors on ne peut plus être (un instant) tranquille(s). On avait déjà tellement de mal à s’arranger avec les valeurs purement humaines. Voilà, mon enfant, voilà ce que c’est que le christianisme. On ne peut plus être tranquille avec vous. Des valeurs humaines, de toutes les valeurs humaines, des simples valeurs humaines, de toutes les valeurs humaines, des simples valeurs humaines vous avez toutes fait des valeurs divines. Vous portez tout à Dieu, vous avez tout rapporté à Dieu. Vous touchez Dieu de partout. De toutes mains, de tous côtés. Vous atteignez, vous blessez Dieu de partout. […]
Vous êtes liés au corps de Jésus par une liaison mécanique telle, mécanique automatique telle, par une technique (de) mystique telle, au corps hostie, au corps victime, au corps martyr, au corps souffrant, au corps douloureux, au corps agonisant, au corps misérable ; que c’est encore et sous une autre forme ; sous une forme toujours nouvelle, toujours ancienne ; toujours autre, toujours la même ; cet éternel mécanisme chrétien, toujours nouveau, toujours ancien, toujours éternel ; cette éternelle liaison ; cette éternelle technique, cet éternel ajustement, cette éternelle mystique ; toujours autre, toujours la même, toujours éternelle ; cette liaison incroyable, invraisemblable, inhumaine sans aucun doute, cette liaison inéquilibrée, déséquilibrée, décentrée, désaxée, boiteuse, la plus invraisemblable, la plus incroyable : la seule réelle, cette liaison (si) profondément, si substantiellement (si) centralement chrétienne, la liaison, l’incroyable liaison, la seule réelle, de l’homme et de Dieu, de l’infini et du fini, de l’éternel et du temporel, de l’éternité et du temps ; de l’éternité et de la temporalité ; et aussi de l’esprit et de la matière, de l’esprit et du corps, de l’âme et de la chair ; cette incroyable liaison de l’âme charnelle ; avec Dieu, en Dieu, avec l’homme, en l’homme.
Cette incroyable, la seule réelle liaison, du Créateur et de la créature. […]
Voilà votre communion. […] Tout est lié à tout et à tous et réciproquement, mutuellement ; mais tout est ainsi lié directement, personnellement. Tous est lié à tout et à tous entre soi et ensemble, en même temps, tout cela est lié au corps de Jésus. Réciproquement ; mutuellement ; directement ; personnellement.
Il y a un retentissement plein de tout sur tout. Et dans la personne de Jésus. Le moindre péché, (et c’est si vite fait, mes frères ; ce qu’il y a de plus facile à faire, de plus vite fait ; un instant), a un retentissement éternel.
La santidad del pueblo, según Péguy
Charles Péguy en su tienda de Cahiers de la Quinzaine, en 1913
Charles Péguy: «Un nouveau théologien, M. Fernand Laudet» (1911)
(Cahiers de la Quinzaine, 24 de septiembre de 1911. En Péguy: Œuvres en prose, 1909-1914. París: Gallimard, 1957, pp. 845-1023. Fragmentos)
Pour nous chrétiens, disons-le hautement, le surnaturel et la sainteté, c’est cela qui est l’histoire, la seule histoire peut-être qui nous intéresse, la seule histoire profonde et profondément réelle et nous accorderions plutôt que c’est tout le reste qui serait de la légende. […]
Il ne peut point pardonner à M. Péguy ce christianisme peuple, directement sorti du peuple. Il aimerait mieux un christianisme plus élégant. Distingué. […]
… les vies, les souffrances, les épreuves, les exercices, les travaux, les Vertus, les grâces, les mérites, les prières de ces innombrables saints, des innombrables saints obscurs. […]
En résumé, et pour nous en tenir à l’extension comme géographique de la sainteté, M. Laudet nie la communion des saints, la participation, la commune participation, il nie les réversibilités, il nie tout le glorieux (et si souvent obscur) appareil de la sainteté. […]
M. Laudet […] paraît ignorer en effet qu’à ne considérer encore que l’extension pour ainsi dire géographique de la sainteté il y a eu et il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de chrétiens, – de saints, – des chrétiens innombrables, – des saints innombrables, – qui ont gagné le ciel les yeux fixés uniquement sur ces longues années d’ombre épaisse qui selon M. Laudetne nous appartiennent pas. […]
M. Lauet paraît ignorer que des milliers et des milliers, que des centaines de milliers d’ouvriers chrétiens ont vécu les yeux uniquement fixés sur l’atelier de Nazareth, que des chrétiens innombrables ont vécu, sont morts, ont gagné le ciel, ont fait leur salut les yeux uniquement fixés sur l’atelier de Nazareth ; que tout atelier chrétien est une image de l’atelier de Nazareth ; que ces ouvriers, que es pauvres, que ces misérables ne peuplent pas seulement le ciel ; qu’on ne voit qu’eux, dans le ciel ; qu’il n’y en a que pour eux ; que le ciel est plein de ces petites gens ; qu’on voit dans le ciel infiniment plus de ces petites gens que de directeurs de revue. […]
Que de même que tout atelier chrétien est une image de l’atelier de Nazareth de même toute famille chrétienne est une image de la famille de Nazareth ; que de même que tout ouvrier chrétien travaille comme Jésus de même tout ouvrier chrétien, tout mère chrétienne aime, instruit, nourrit, élève ses enfants comme Joseph et Marie aimaient, instruisaient, nourrissaient, élevaient Jésus, tout fils chrétien aime, honore, nourrit ses parents comme Jésus aimait, honorait, nourrissait son père et sa mère. […]
qu’un pauvre homme dans son lit, que le dernier des malades peut au regard de Dieu, (et la chrétienté tout entière l’ignorant jusqu’au Jugement), mériter secrètement plus que le plus glorieux des saints. Faut-il renvoyer M. Laudet à la Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. […]
Jésus endossant pour ainsi dire cette loi et la loi d’humilité en a fait une redevance d’amour. Ainsi est des centaines de milliers d’ateliers chrétiens n’ont plus été, ne sont plus que des imitations de l’atelier de Nazareth. L’homme aujourd’hui, telle est la loi nouvelle, tel est le statut nouveau, l’homme aujourd’hui qui travaille n’est plus un forçat qui fait son temps. L’homme aujourd’hui qui travaille est un homme qui fait comme Jésus, qui imite Jésus. Le travail quotidien n’est plus que premièrement une peine. Il est aujourd’hui une imitation d’un auguste travail quotidien. L’homme qui fait sa journée est bon. […]
Si M. Laudet avait quelque idée, quelque connaissance de ce que c’est qu’un christianisme et plus profondément de ce que c’est que le tissu de la chrétienté même il saurait que la famille chrétienne, qui fait le tissu même, est étroitement imitée de la famille de Nazareth. […]
Les enfants son littéralement à l’école du petit Jésus. […]
Si la vie privée de Jésus ne nous appartient pas, monsieur Laudet, qu’est-ce que ces admirables textes viennent faire dans les Évangiles. […]
Venant ainsi, conduits ainsi non plus seulement à la simple extension et à la géographie mais à la profondeur et à ce que nous nous sommes permis de nommer la géologie de la sainteté la relation du public au privé dans la sainteté, en matière de sainteté, nous paraîtra être la suivante : que en sainteté, en matière de sainteté c’est le privé qui porte le public et que le public est tout soutenu, tout nourri du privé. En sainteté, en matière de sainteté le public plonge dans le privé, les vertus publiques se soutiennent littéralement, se nourrissent, se recrutent des vertus privées. En matière de sainteté le public vient du privé. […]
La partie publique de la vie ont toujours été considérées par les saints qui en ont eu littéralement comme des missions, comme des envois, comme des départs, d’où ils ne demandaient qu’à revenir. […]
Les saints chrétiens, les saints publics étaient éminemment des hommes, des saints, des appelés, vocati, qui pour se garantir dans l’extrême danger de missions extraordinaires y portaient d’abord, commençaient par y transporter les vertus ordinaires, usuelles, les vertus de tous les jours, familières, les vertus à la main, virtutes manu factas. […]
Un saint n’était saint que si le tissu même de sa vie était sainte, que si sa vie quotidienne était sainte, que si sa vie privée était sainteté. […]
Nous ne voulons qu’une grande histoire ait de la grandeur, et même qu’elle soit authentique, une histoire de mémoire, une histoire publique, une histoire d’État, une histoire d’histoire, que si nous sentons, que si nous savons qu’elle provient directement du peuple. […] Nous voulons qu’une grande histoire soit nourrie directement du peuple. […] Nous voulons toucher le fond, le rude ; le réel. Et nous avons l’impression de ne toucher le fond que quand nous touchons le peuple. […]
Le peuple seul garantit le héros. Le peuple seul garantit le saint. Le peuple seul est assez terre. […]
L’espérance ne peut jouer que dans un minimum de charité. L’espérance, la lueur d’espérance ne peut s’allumer que d’un certain feu. De l’athéisme réactionnaire, de l’athéisme bourgeois on ne peut rien attendre, que cendre et que poussière, parce que tout n’y est que mort et que cendre. C’est un athéisme sans espoir. […]
Vae tepidis ; malheur aux tièdes. Honte au honteux. Malheur et honte à celui qui a honte. […] Il s’agit de savoir quelle est la source profonde de l’incréance, quelles sont les profondeurs de ces manques, d’où viennent, d’où remontent ces incrédulités. Or nulle source n’est aussi honteuse que la honte. Et la peur. Et de toutes le peurs la plus honteuse est certainement la peur du ridicule, d’être ridicule, de paraître ridicule, la peur de passer pour un imbécile. On peut croire ou ne pas croire (enfin nous nous entendons ici). Mais honte à celui qui renierait son Dieu pour ne point faire sourire les gens d’esprit. […]
Si vous retranchez du christianisme, monsieur Laudet, de la chrétienté, de la sainteté, de ce qui nous appartient l’enfance du Christ, que faites-vous de ces innombrables œuvres dont nos cathédrales sont plaines. Que faites-vous de nos cathédrales mêmes et de nos églises. Que faites-vous de tant d’œuvres, non point œuvres d’art seulement, comme les voient nos modernes, mais œuvres d’une éternelle piété. Œuvres qui ne se détachent point du culte et de la prière et de l’adoration au point qu’elles sont comme, qu’elles sont littéralement une inscription charnelle, une inscription temporelle, une inscription lapidaire, pétrée, dans la pierre même, du culte et de la prière, la plus intérieure, et de l’adoration la plus intime. Le corps de l’adoration. […] œuvres dont il faut dire qu’elles sont le corps même du culte, le corps même de la prière, le corps même de l’adoration. L’inscription dans la dure, dans la temporelle, dans l’extérieure pierre de la vie intérieure la plus profonde et la plus tendre. […]
Bannir de chrétienté la jeunesse, nous retrancher de notre christianisme l’enfance notre premier héritage, fleur de chrétienté, source de notre grâce. Retrancher, bannir de chrétienté, source de notre grâce. Retrancher, bannir de chrétienté la pauvreté, le travail, la famille, ces trois piliers de toute vie, quelle tentative de décomposition organique, de désorganisation, de démembrement. […]
Notre thèse, monsieur Laudet, notre position chrétienne, notre proposition est, la voix de notre raison est, (et non pas seulement le cri de notre cœur), que la sainteté est la santé même. […] Que nos saints sont sains. Sanctos esse sanos. Que cette sainteté est la santé même, quelle est la plus haute santé spirituelle, la plus ferme, la plus profonde (904). […] C’est le pécheur qui est malade. […]
La communion des saints est, en un de ses sens, précisément cette saisie directe que nous avons, nous chrétiens, non seulement des saints du quinzième siècle, mais ensemble des saints de tous les siècles, et autant que de tous autres des saints du premier siècle, et ensemble éminemment de Jésus, par la prière et par les sacrements, par la grâce, par les mérites de Jésus-Christ et des saints, cette saisie immédiate, instantanée, intemporelle, éternelle, sans avoir à nous faire aucune archéologie d’âme. […]
A parler rigoureusement, à parler proprement tous les âges sont des âges de foi. Tous les siècles sont les siècles de Jésus (906). […] Depuis Jésus, post Christum natum, tous les siècles temporels sont également situés sous le même niveau, tous les siècles temporels sont régulés sous la même commune régulation interne, qui est la régulation de la loi d’amour. En ce sens tous les siècles de chrétienté se valent, sont les mêmes, sont même le même. Depuis Jésus touts les siècles temporels sont les mêmes, sont le même, sont de la même nature infiniment profonde, de la même texture mystique, littéralement sont de la même éternité. […]
C’est une question éternelle que de savoir si nos saintetés modernes, c’est-à-dire nos saintetés chrétiennes plongeant dans le monde moderne, dans cette vastatio, dans cette abîme d’incrédulité, d’incréance, d’infidélité du monde moderne, isolées comme des phares qu’assaillirait en vain une mer depuis bientôt trois siècles démontée ne sont pas, ne seraient pas le plu agréables aux yeux de Dieu. […]
Miles Christi, tout chrétien est aujourd’hui un soldat ; le soldat du Christ. Il n’y a plus de chrétien tranquille. Ces Croisades que nos pères allaient chercher jusque sur les terres des Infidèles, non solum in terras Infidelium, sed, ut ita dicam, in terras ipsas infideles, ce sont elles aujourd’hui qui nous ont rejoints au contraire, ce sont elles à présent qui nous ont rejoints, et nous les avons à domicile. Nos fidélités sont des citadelles. […]
Le moindre de nous est un soldat. Le moindre de nous est littéralement un croisé. […] Ainsi nous sommes tous des îlots battus d’une incessante tempête et nos maisons sont toutes des forteresses dans la mer. […] Nous sommes tous à la frontière. La frontière est partout. […]
Que tous les siècles de tous les temps lui appartiennent, et ce qui est encore infiniment plus grave, infiniment nouveau, ce qui est le mystère même et le secret et le centre de la Rédemption qu’il appartient à tous les siècles de tous les temps. […]
Je veux bien marcher contre le Parti Intellectuel. J’ai l’habitude. […]
Je ne crois pas que j’aie jamais parlé du monde catholique. J’ai parlé souvent de l’Église, de la communion. Je ne me sens pleinement à moi, je ne touche vraiment le fond de ma pensée que quand j’écris la chrétienté. […]
Le dirai-je, elle était trop profondément peuple et encore plus trop profondément chrétienne et trop profondément sainte. […]
Appelée par une vocation divine en terre humaine, envoyée en mission divine en terre humaine non seulement elle n’opéra jamais, mais elle ne demanda jamais d’opérer, elle ne pria jamais d’opérer que par des moyens humains. […]
Par un recoupement unique de ces deux races, par une élection, par une vocation unique dans l’histoire du monde elle est à la fois sainte entre tous les héros, héroïque entre toutes les saintes. […]
Le pécheur et le saint sont deux pièces essentielles complémentaires, mutuellement complémentaires, qui jouent l’une sur l’autre, et dont l’articulation l’une sur l’autre fait tout le secret de chrétienté. […] Le pécheur tend la main au saint, donne la main au saint, puisque le saint donne la main au pécheur. Et tous ensemble, l’un par l’autre, l’un tirant l’autre, ils remontent jusqu’à Jésus, ils font une chaîne qui remonte jusqu’à Jésus, une chaîne aux doits indéliables. […]
Le chrétien ne se définit point par l’étiage, mais par la communion. […]
Jeanne d’Arc est mon modèle, puisque j’ai entrepris de consacrer tout ce que j’ai à la représentation de cette grande sainte, et c’est Joinville qui est mon maître. […]
«La reconciliación» (Maeztu)
Discurso de Maeztu durante el banquete celebrado en su honor, el 11 de diciembre de 1910
Ramiro de Maeztu: «La reconciliación» (1922)
(El Sol, 4-VII-1922, p. 1)
La posibilidad de reconciliar el ideal mundano de mis abuelos liberales con el ideal ultramundano de mis abuelos carlistas no se me ocurrió sino un día en que leí en Irineo que el espíritu es la unidad del alma y del cuerpo. Relacioné esta definición con los asertos de San Pablo respecto de que al morir el hombre carnal resucita convertido en hombre espiritual y de que en el cielo no hay matrimonios, nacimientos ni muertes. Deduje que donde alma y cuerpo son una misma cosa, no existe el proceso de las generaciones, porque la vida es perdurable. Traté de explicármelo todo ello con ejemplos, en los que imaginé que el alma y el cuerpo son como la corriente eléctrica y el alambre o como el oleaje y el agua del mar, mientras que en la vida perdurable son una misma cosa alambre y corriente, oleaje y agua. Y acabé por decirme que, por lo mismo que la vida perdurable es la vida profunda, la vida que anima las últimas reconditeces materiales, tiene que ser, para nosotros, misteriosa.
Esta es, por cierto, la doctrina ortodoxa. En ella se nos habla de la resurrección de la carne y de la vida perdurable; de lo que no se nos habla en el Credo es de la inmortalidad del alma; que nos es, sin embargo, más familiar que la resurrección, debido a la dificultad de colocar al “hombre sensual medio” en posición de aceptar la resurrección de la carne y a la relativa facilidad de hacerle entender la inmortalidad del alma. Pero la doctrina de la inmortalidad es peligrosa. Tiene un carácter semimaniqueo. Implica la primacía y superioridad del alma sobre el cuerpo. De ella se desprende un ascetismo negador del cuerpo y de las cosas pertinentes al cuerpo, deleznables por perecederas. Las naciones son perecederas. La civilización es perecedera. La sociedad es perecedera. Y todo lo que es perecedero importa poco. Lo único importante es salvar la chispa inmortal, que es el alma. No es ya difícil comprender la razón de la rebeldía del ideal mundano contra el ultramundano, ni la de su oposición irreductible; pero tampoco es ya imposible vislumbrar la posibilidad de emplear fructuosamente en entendernos algo de la energía malgastada por nuestros mayores en expresar su desacuerdo.
El ideal mundano y el ultramundano se han estado peleando dos siglos. Concebid ahora el ideal espiritual. Espíritu es la unidad de cuerpo y alma; pero como es imposible la unidad en esta vida, el ideal consiste en su armonía. Aplicad el ideal armónico a los ideales antagónicos. La reconciliación es inmediata. Este mundo no lo es todo. En esto tienen razón los ultramundanos. Pero este mundo es parte esencial del otro. Luego tienen razón los mundanos al subrayar la magnitud de su importancia. Antes se quedan cortos. Lo que hace la doctrina del ultramundo es multiplicar y potenciar “ad infinitum” el valor de nuestras acciones en el mundo. Hay que tener cuidado con lo que se hace, porque las consecuencias son perennes. El valor del mundo es muy superior a lo que los mundanos se imaginan. Y ésta no es una transacción. Aquí no se trata de que la física se enseñe por gentes que no creen en la importancia de la física, ni de fingir una religiosidad que no se siente al objeto de mantener sumiso al pueblo. La idea espiritual funde el cuerpo y el alma del mundo la unidad superior del ultramundo. Pero el ultramundo no es sino este mundo, tal como lo viviremos cuando alcancemos las consecuencias plenas y totales de nuestras acciones.
Tiene razón el Kempis cuando proclama la vanidad de las riquezas, de los honores, de las satisfacciones de la carne; pero no cuando dice que es vano amar lo que pasa tan pronto, porque esto que pasa es también perdurable, y por eso precisamente es tan terrible amar en el mundo lo que es malo. Tiene razón el Kempis cuando nos muestra la capacidad de los santos para servir a Dios “en el hambre y en la sed, en el frío y en la desnudez, en el trabajo y en las fatigas, en las velas y en los ayunos”; porque ésta es la grandeza de la religión y la obra de los ultramundanos: exaltar nuestro ser, hasta oponerlo al tumulto del mundo. Imaginad un bosque en que los árboles están pegados a la tierra por su naturaleza vegetal. He aquí un árbol que saca sus raíces y las emplea, como brazos de un pulpo, en trasladarse de un lado a otro por el suelo. ¿No resonará por todo el bosque un gran hosanna de liberación? Así actúa la religión sobre los hombres. Sobre la fuerza de los instintos, la pesadumbre del pasado y la alternación de las venganzas, el cristianismo infunde la capacidad de perdonar a los deudores y de vivir la vida nueva, libres de la historia.
Pero esta libertad no se nos da para negar el mundo, ni para escaparnos, como Brandt, a un desierto de hielo, ni para que nos sintamos desterrados y extraños en el mundo, como dice el Kempis, sino para mejorar el mundo. Hay que empezar por no ser mundo para poder mejorarlo, hay que hacer ejercicios espirituales para templar el alma, hay que cultivar el ascetismo, pero no para negar el cuerpo, sino para vigorizarlo y depurarlo. El viejo progresista tiene tanta razón como el Kempis. Hay que hacer carreteras. Hay que construir escuelas. No se trata meramente de que las carreteras y las escuelas son cosas buenas, sino de que este mundo es parte del otro, y, según lo que sembremos, así recogeremos. La ignorancia de este mundo es mala; pero la ignorancia del otro será mucho peor, porque en el otro mundo el hombre podrá situarse en el centro de las cosas y mirar las realidades desde dentro, por lo que la ignorancia será tormento insoportable en una vida donde el pleno saber resultará posible. Tienen razón los liberales cuando se revuelven contra la sujeción y el estrechamiento de los hombres. Hay que multiplicar las potencias humanas. Bien está el amor de la verdad, de la riqueza (siempre que no sea a expensas de la pobreza ajena) y la higiene. Los mundanos tienen razón en todo eso. Pero sus amores no perderían nada porque se proyectasen en la luz y perspectiva infinitas del ultramundo.
Sólo dejan de tener razón los ultramundanos cuando niegan el mundo, y los mundanos cuando niegan el ultramundo. Ambos son reales. El mundo es el ultramundo. El ultramundo es el mundo en la plenitud de sus consecuencias, el mentiroso en sus mentiras, el vanidoso en sus vanidades, el cariñoso en sus cariños, el veraz en sus verdades. El malo en su maldad, hasta que no pueda soportarla y pida la muerte eterna; el bueno en su bondad, eternamente. Por lo que Maragall tienen razón en su Canto espiritual cuando se contenta con este mismo mundo. El otro es este mismo; pero nuestros ojos podrán atravesarlo y descansar en Dios
Humanismo integral (Maritain)
Jacques Maritain y Pablo VI
Jacques Maritain: Humanismo integral (1936)
(Jacques Maritain: Humanismo integral [1936]. Madrid: Palabra, 2001, pp. 156-164. Traducción de Alfredo Mendizábal. Fragmento)
La misión temporal del cristiano en la transformación del régimen social
Querríamos ahora proponer algunas consideraciones respecto a la misión temporal del cristiano en el trabajo de transformación del régimen social. Advirtamos primero que, para el pensamiento cristiano al menos, parece haberse liquidado el dualismo de la edad precedente. Para el cristiano, tanto el separatismo como el dualismo, de tipo maquiavélico o de tipo cartesiano, han acabado. En nuestros días se produce un importante proceso de integración, por retorno a un saber teológico y filosófico a la vez; a una síntesis vital.
Las cosas del dominio político y económico deben, pues, encontrarse conforme a su naturaleza, vinculadas a la ética.
Por otra parte, ese adquirir conciencia de lo social, que faltaba más o menos al mundo cristiano o llamado cristiano de la Edad Moderna, comienza por fin a realizarse para el cristiano. Hay en ello un fenómeno de importancia considerable, tanto más cuanto esa conciencia se adquiere, según parece, cada día más, por una justa comprensión de la historia moderna y de sus procesos normales, viciados ayer por el materialismo capitalista, hoy por el materialismo comunista subsiguiente.
Al mismo tiempo aparece lo que puede llamarse misión propia de la actividad profana cristiana respecto al mundo y a la cultura; diríase que mientras la Iglesia, cuidadosa ante todo de no enfeudarse a ninguna forma temporal, se libera cada día más, no del cuidado de juzgar desde lo alto, sino del de administrar y gestionar lo temporal y el mundo, el cristiano se encuentra entregado a ello cada vez más, no en cuanto cristiano o miembro de la Iglesia, sino en cuanto miembro de la ciudad temporal, es decir, en cuanto miembro cristiano de esta ciudad, consciente de la tarea que le incumbe, de trabajar por la instauración de un nuevo orden temporal del mundo.
Si así es, en seguida se ve qué problemas se plantearán ante el cristiano, en este orden de ideas.
Necesitará elaborar una filosofía social, política y económica, no limitada tan sólo a los principios universales, sino capaz de descender hasta las realizaciones concretas, lo que supone todo un vasto y delicado trabajo; este trabajo ha comenzado ya y las encíclicas de León XIII y de Pío XI han fijado sus principios. Advirtamos que se trata de un trabajo de razón, iluminada por la fe, pero trabajo de razón sobre el cual sería vano esperar un acuerdo unánime en cuanto se dejan los principios para descender a las aplicaciones. Si hay diversidad de escuelas en teología dogmática, habrá fatalmente también diversidad de escuelas en sociología cristiana y en política cristiana; y tanto más cuanto más se aproxime uno a lo concreto. Sin embargo, puédese llegar a una doctrina común en cuanto a las verdades más generales, y en lo demás, lo importante es que se desprenda una dirección de conjunto verdaderamente precisa, para un número suficientemente grande de espíritus.
Pero el cristiano consciente de estas cosas deberá también abordar la acción social y política, no sólo para poner al servicio de su país, como siempre se ha hecho, las capacidades profesionales que en este aspecto pueda ofrecer, sino, también y además, para trabajar, como acabamos de decir, por la transformación del orden temporal.
Ahora bien, es claro que, siendo lo social-cristiano inseparable de lo espiritual-cristiano, es imposible que una transformación vitalmente cristiana del orden temporal se produzca de la misma manera y por los mismos medios que las demás transformaciones y revoluciones espirituales. Si tiene lugar, será en función del heroísmo cristiana.
“La revolución social será moral o no existirá”. Esta célebre frase de Charles Péguy puede ser entendida al revés. “No significa: antes de transformar el régimen social es preciso que todos los hombres se hayan convertido a la virtud. Así comprendida, no sería sino un pretexto farisaico para eludir todo esfuerzo de transformación social. Las revoluciones son obra de un grupo de hombres relativamente poco numerosos que les consagran todas sus fuerzas: a ellos es a quienes la frase de Péguy se dirige. Significa: no podéis transformar el régimen social del mundo moderno sino provocando al propio tiempo –y primeramente en vosotros mismos– una renovación de la vida espiritual y de la vida moral, ahondando hasta los fundamentos espirituales y morales de la vida humana, renovando las ideas morales que presiden la vida del grupo social como tal y que despiertan en sus entresijos un ímpetu nuevo…
Pues bien, el más verdadero y perfecto heroísmo, el heroísmo del amor, ¿nada tiene que decir aquí? Una vez ya reconocido, por la conciencia cristiana, el dominio propio de lo social, con sus realidades, sus técnicas, su “ontología” característica, la santidad cristiana ¿no tendrá que trabajar también allí mismo donde trabaja el heroísmo particular de la hoz y el martillo, o del fascio, o de la cruz gamada? ¿Acaso no es hora de que la santidad descienda del cielo de lo sagrado (que le habían reservado cuatro siglos de estilo barroco) a las cosas del mundo profano y de la cultura, trabaje en transformar el régimen terrenal de la humanidad y haga obra social y política?
Sí, ciertamente, a condición de que siga siendo santidad y no se pierda por el camino. Ahí está todo el problema.
Para la comunidad cristiana hay dos peligros inversos, en una época como la nuestra: el peligro de no buscar la santidad sino en el desierto, y el peligro de olvidar la necesidad del desierto para la santidad; el peligro de encerrar exclusivamente en el claustro de la vida interior y de las virtudes privadas el heroísmo que debe ofrecer el mundo, y el peligro de concebir a éste –cuando desborda sobre la vida social y se aplica a transformarla– como lo conciben sus adversarios materialistas, pervirtiéndolo y disipándolo en un tipo de heroísmo absolutamente exterior. El heroísmo cristiano no tiene las mismas fuentes que los otros; procede del corazón de un Dios flagelado y escarnecido, crucificado fuera de las puertas de la ciudad.
Hora es ya para él de poner de nuevo mano en las cosas de la ciudad terrenal, como antaño en los siglos medievales, pero sabiendo bien que su fuerza y su grandeza son, por lo demás, de orden distinto.
Una renovación social vitalmente cristiana será así obra de santidad o no existirá; y me refiero a una santidad vuelta hacia lo temporal, lo secular, lo profano. ¿No ha conocido el mundo jefes de pueblos que han sido santos? Si una nueva cristiandad surge en la historia, será obra de una tal santidad.
Un estilo nuevo de santidad
Henos aquí llegados a un nuevo y último problema, sobre el cual sólo diré pocas palabras. Si nuestras observaciones son exactas, hay derecho a esperar el crecimiento de una santidad de nuevo estilo.
No hablamos de un nuevo tipo de santidad; la palabra sería equívoca (el cristiano reconoce sólo un tipo de santidad eternamente manifestado en Cristo). Pero las cambiantes condiciones históricas pueden dar lugar a modos nuevos, a estilos nuevos de santidad. La santidad de Francisco de Asís tiene fisonomía distinta de la de los Estilitas; la espiritualidad de los jesuitas, la de los dominicos o la de los benedictinos responde a estilos diferentes. Puede así pensarse que el adquirir conciencia del oficio temporal del cristiano reclama un estilo nuevo de santidad, que se puede caracterizar, ante todo, como la santidad y la santificación de la vida profana.
En verdad, este estilo es nuevo, sobre todo, respecto a ciertas concepciones erróneas y materializadas. Cuando éstas sufren una especie de postración sociológica –lo que frecuentemente ocurrió en la edad humanista clásica–, la distinción bien conocida de los estados de vida (estado regular y estado secular), comprendida en sentido material, se entiende de manera inexacta; el estado religioso, es decir, el de los que se entregan a buscar la perfección, es considerado entonces como el estado de los perfectos, y el estado secular como el de los imperfectos, de tal manera que el deber y la función metafísica de los imperfectos es el ser imperfectos y quedarse tales; llevar una vida mundana no demasiado piadosa y sólidamente anclada en el naturalismo social, ante todo en el de las ambiciones familiares. Hubiérase tenido por escandaloso que unos laicos tratasen de vivir de otro modo; se les pedía sólo que hiciesen prosperar en la tierra, por fundaciones pías, a los religiosos que, en cambio, les ganarían el Cielo; así se guardaba el orden debido.
Esta manera de concebir la humildad de los laicos parece haber estado bastante difundida en los siglos XVI y XVII. Así es como el catecismo explicado a los fieles del dominico Carranza, arzobispo entonces de Toledo, fue condenado por la Inquisición española, en vista del informe del célebre teólogo Melchor Cano. Éste declaraba “completamente condenable la pretensión de dar a los fieles una instrucción religiosa que sólo conviene a los sacerdotes… Se elevaba así vigorosamente contra la lectura de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, contra los que tomaban por tarea el confesar todo la jornada. El celo desplegado por los espirituales para llevar a los fieles a confesarse y a comulgar era, según él, bien sospechoso y se le atribuye haber dicho en un sermón que, a su parecer, uno de los signos de la venida del Anticristo era la gran frecuencia de sacramentos”. (Sandreau: “Le mouvement antimystique en Espagne en XVIe siècle”. Revue du Clergé français, 1 de agosto, 1917).
Más profundamente –y con ello abordamos una cuestión muy importante para la filosofía de la cultura– puede advertirse que existe una manera no cristiana, sino pagana, de entender la distinción entre lo sagrado y lo profano.
Para la antigüedad pagana, santo era sinónimo de sagrado, es decir, lo que –física, visible y socialmente– está al servicio de Dios. Y sólo en la medida en que las funciones sagradas la penetraban, la vida humana podía tener un valor ante Dios. El Evangelio ha cambiado esto profundamente, interiorizando en el corazón del hombre, en el secreto de las relaciones invisibles entre la personalidad divina y la personalidad humana, la vida moral y la vida de santidad.
Desde entonces ya no se opone lo profano a lo sagrado como lo impuro a lo puro, sino como un cierto orden de actividades humanas; aquellas cuyo fin específico es temporal se oponen a otro orden de actividades humanas socialmente constituidas para un fin específico espiritual. Y el hombre entregado a este orden profano o temporal de actividades puede y debe, como el hombre entregado al orden sagrado, tender a la santidad, para llegar él mismo a la unión divina y para atraer hacia el cumplimiento de las voluntades divinas el orden entero al cual pertenecen. De hecho, este orden profano, en cuanto colectivo, sería siempre deficiente, pero debemos, no obstante, esforzarnos en que sea lo que debe ser; pues la justifica evangélica requiere por sí el penetrarlo todo, el apoderarse de todo, el descender a lo más profundo del mundo.
Puede advertirse que este principio evangélico se ha traducido y manifestado progresivamente en los hechos, y su proceso de realización aún no está terminado.
Tales observaciones nos hacen comprender mejor la significación de ese nuevo estilo de santidad, de esa nueva etapa en la santificación de lo profano, de la que hablábamos antes.
Agreguemos que ese estilo, por afectar a la espiritualidad misma, habrá de tener, sin duda, caracteres particulares propiamente espirituales –por ejemplo, una insistencia sobre la simplicidad, sobre el valor de las vías ordinarias, sobre aquél rasgo específico de la perfección cristiana, de ser la perfección no de un atletismo estoico de virtud, sino de un amor entre dos personas, la persona creada y la Persona Divina; y, finalmente, sobre la ley de descendimiento del Amor increado a las profundidades de lo humano, para transfigurarlo sin aniquilarlo (de lo que hemos hablado en el capítulo precedente); ciertos santos de la edad contemporánea parecen haberse encargado de hacernos presentir la importancia de estos caracteres. Entra también en el orden de las cosas el que no sea en la vida profana, sino en ciertas almas ocultas al mundo (unas viviendo en el mundo, otras en lo alto de las más elevadas torres de la cristiandad, es decir, en las Órdenes más altamente contemplativas), donde comienza a aparecer ese nuevo estilo y ese nuevo impulso de espiritualidad, que desde allí ha de extenderse por la vida profana y temporal.
«Lettre sur le monde bourgeois» (Maritain)
Jacques Maritain
Jacques Maritain: «Lettre sur le monde bourgeois» (1933)
(Esprit, 1 de marzo de 1933. En Esprit, 1er Année, tome I, Janvier-Mars 1933, pp. 897-908)
Toronto, 24 janvier 1933
Cher Monsieur,
Mon temps est tout entier pris ici par la préparation de mes cours et le travail universitaire, et je ne peux pas trouver le loisir nécessaire pour composer l’article que je vous avais promis. Je voudrais cependant, pour ne pas manquer tout à fait à ma promesse, vous envoyer pour votre numéro de Mars quelques notes hâtives concernant la question posée par vous, et que vous formuliez, si je me souviens bien : rupture entre l’ordre chrétien et le désordre établi ; je suppose que par ces derniers mots vous entendez le monde de [‘humanisme anthropocentrique, que le vocabulaire courant, fort insuffisant d’ailleurs, désigne dans son état actuel comme le monde « bourgeois » ou « capitaliste » : ce qui n’en marque qu’un des aspects.
A la vérité l’idée seule d’un lien ou d’une solidarité entre le christianisme et ce monde-là est une idée souverainement paradoxale. Que beaucoup de nos contemporains puissent croire de bonne foi, selon le plus efficace cliché de la propagande athéiste, que la religion et l’Eglise sont liées à la défense des intérêts d’une classe, et de l’« éminente dignité » du capitalisme, du militarisme etc., c’est bien le signe que la bonne foi n’est pas nécessairement l’intelligence, et que l’opinion des hommes se meut parmi des ombres où les apparences des choses sont renversées.
Le monde issu des deux grandes révolutions de la Renaissance et de la Réforme a des dominantes spirituelles et culturelles nettement anticatholiques ; chaque fois qu’il a pu suivre librement son instinct il a persécuté le catholicisme, sa philosophie est utilitaire, matérialiste ou hypocritement idéaliste, sa politique est machiavélique, son économie libérale et mécaniste. Le « monde bourgeois » a des pères qui ne sont pas les Pères de l’Eglise, qu’on les cherche avec Max Weber du côté de Calvin ou avec M. Seillière du côté de Rousseau, sans oublier l’Ange cartésien des idées claires. Ce monde est né d’un grand mouvement du cœur vers la sainte possession des biens terrestres, qui est à l’origine du capitalisme, du mercantilisme et de l’industrialisme économiques comme du naturalisme et du rationalisme philosophiques. Les condamnations de l’usure par l’Eglise demeurent au seuil des temps modernes comme une interrogation brûlante sur la légitimité de l’économie de ces temps.
L’Eglise est dans le monde mais n’est pas du monde. Si elle engage les hommes à se montrer fidèles aux formes sociales éprouvées par le temps, ce n’est pas qu’elle soit attachée à l’une ou l’autre de ces formes, c’est qu’elle sait que la stabilité des lois est un des biens de la multitude ; mais elle a constamment montré au cours de l’histoire que les renouvellements politiques et sociaux ne lui font pas peur, et qu’elle a un sens singulièrement exempt d’illusions de la contingence des choses humaines. Elle enseigne l’obéissance aux autorités temporelles et aux justes lois, parce que tout pouvoir légitime de l’homme sur l’homme vient de Dieu ; mais (sauf à l’égard d’un pouvoir temporel ayant rôle proprement ministériel à l’égard du spirituel, comme c était le cas pour l’Empire au moyen âge) ce n’est pas elle qui institue les autorités temporelles, elle sanctionne celles qui sont là, (sans interdire qu’on cherche à les changer, ni qu’on résiste, par la force au besoin, à un pouvoir tyrannique). Elle cherche, pour pouvoir mieux procurer le salut des âmes, et afin que les Etats eux-mêmes respectent les finalités de leur propre nature, à s’accorder avec la puissance séculière. Mais elle n’ignore pas que la plupart du temps, — parce que le monde détourné de Dieu, se soumet à un prince qui n’est pas Dieu (totus in maligno positus est mundus), — traiter avec cette puissance est un peu comme traiter avec le diable. Et somme toute un diable en vaut un autre. Il suffit qu’il dure pour éclipser les droits de celui qu’il a supplanté. A la vérité, peut-être parce que le régime médiéval formé sous sa protection continuait d’occuper son souvenir comme il avait si longtemps occupé ses soins tutélaires, l’Eglise catholique a mis beaucoup de temps à s’accommoder du régime bourgeois, et je crois me rappeler que M. Groethuysen a écrit un ouvrage où il lui en fait un reproche ; elle n’a jamais été liée à ce régime, et à quelques persécutions qu’elle puisse être exposée dans ceux qui lui succéderont (elle a l’habitude, supra dorsum meum fabricaverunt peccatores), on peut croire qu’elle ne le regrettera pas beaucoup. Elle est parfaitement libre à son égard.
Pour comprendre le paradoxe dont je parlais tout à l’heure, et comment on a pu croire la religion liée dans ses principes à la civilisation « bourgeoise » ou « capitaliste », il faut pénétrer dans un monde d’apparences et de confusions ; cette croyance absurde a pour origine la confusion fondamentale, que j’ai déjà signalée dans de précédentes études, entre l’Eglise et le monde chrétien, ou entre la religion catholique et le comportement social de la moyenne des catholiques appartenant aux « classes dirigeantes », —c’est-à-dire en définitive entre l’ordre spirituel et l’ordre temporel. L’Eglise comme telle a les promesses de la vie éternelle, et le prince de ce monde n’a pas de part en elle ; il a sa part dans le monde chrétien.
Le monde chrétien issu de la décomposition de la chrétienté médiévale a consenti à beaucoup d’iniquités, — je parle là d’une sorte de défaillance collective historique, à l’égard de laquelle la recherche des responsabilités individuelles n’a guère de sens ; c’est ce monde-là que, tout en préparant d’autres naissances, Dieu laisse aller à son poids de mort.
La mission d’un Léon Bloy a été d’annoncer ces choses, et de les crier sur les toits. Il est singulier d’observer à quel point les aveux de cette sorte semblent en quelque manière indécents à beaucoup de chrétiens d’aujourd’hui ; on dirait qu’ils redoutent de gêner l’apologétique, ils préfèrent s’en prendre aux desseins des méchants, et se comporter envers l’histoire en manichéens, comme si les méchants ne relevaient pas du gouvernement du Seigneur, mais seulement de celui du diable. Les anciens juifs, et même les Ninivites, ne faisaient pas tant de façons.
La défaillance dont je parle, et qui concerne avant tout l’ordre du social, ou plutôt du spirituel incarné dans le social, est celle d’une masse sociale ou culturelle prise clans son (imparfaite) unité, dans ses structures collectives et dans son « esprit objectif », plutôt que d’une série d’individus pris chacun à chacun : disons qu’elle est celle de la civilisation de nom chrétien, et de nous tous en tant que nous sommes engagés dans cette civilisation. Nicolas Berdiaeff a dit là-dessus, dans le premier numéro d’Esprit, d’importantes vérités sur lesquelles je n’ai pas à revenir. Je voudrais plutôt essayer de voir quelles sont les raisons de ce fait historique.
Une première raison est tout à fait générale. Elle tient à cette vérité universelle que le mal est plus fréquent que le bien dans l’espèce humaine. Il est donc naturel qu’il y ait plus de « mauvais chrétiens » que de «bons chrétiens » dans une civilisation chrétienne, et surtout dans les couches dominantes (et par là même plus exposées) de cette civilisation. A partir du moment où celle-ci perd son esprit propre et les structures qui lui étaient liées, comme il est arrivé pur la chrétienté à partir de la Renaissance et de la Réforme, un autre esprit collectif naîtra donc en elle, et qui sera d’autant plus lourd et ténébreux qu’on s’éloignera davantage du centre vital de la foi et de l’Église. C’est ainsi qu’on arrivera à la naturisation de la religion dont j’ai parlé dans Religion et Culture, et à l’utilisation déiste ou athéiste (c’est pratiquement la même chose) du christianisme pour des fins temporelles. Ce thème de la religion « bonne pour le peuple » a pris un grand développement au temps du despotisme éclairé, et il a eu me semble-t-il, une destination politique (au bénéfice du Prince) avant d’avoir une destination économique (au bénéfice du Riche). « Ce système du merveilleux semble décidément fait pour le peuple », écrivait. Frédéric II ; et encore : « Je ne sais qui pourrait travailler à cette question : est-il permis de tromper les hommes ? Je vais voir à arranger la chose ». L’Académie de Berlin mit la question au concours en 1780. « A cette question, répond Johann-Friedrich Gillet, l’un des lauréats du concours, je réponds avec assurance : oui ! pour des motifs importants, et suffisants d’après mes idées : le peuple est peuple, il le restera éternellement, il doit le rester ; et puis l’histoire de tous les temps — du nôtre encore — prouve par des centaines d’exemples que le peuple étant trompé, le peuple lui-même et ses conducteurs s’en sont fort bien trouvés… »
Mais à la défaillance historique dont nous parlons il est d’autres causes plus particulières, et qui nous intéressent de plus près, je voudrais essayer de les indiquer ici, si imparfaitement que ce soit.
Dans la chrétienté médiévale, c’est d’une manière comme irréfléchie et par l’instinct spontané de la foi, et c’est, si je puis dire, in utero Ecclesiae que la civilisation était orientée vers une réalisation de l’Evangile non seulement dans la vie des âmes, mais aussi dans l’ordre social-temporel. Lorsqu’avec 1′ « âge réflexe » la différenciation interne de la culture est devenue le processus prépondérant, et que l’art, la science, la philosophie, l’Etat, se sont mis, chacun à prendre conscience de soi-même (et quelle terrible conscience), il ne me paraît pas inexact de dire qu’il n’y a pas eu de semblable prise de conscience portant sur le social comme tel et sur la réalité propre qu’il constitue. Et comment eût-ce été possible dans un monde qui allait grandir sous le signe cartésien ?
C’est donc par d’admirables initiatives de miséricorde spirituelle et corporelle que l’instinct de l’amour chrétien s’est efforcé au cours des siècles modernes de porter remède aux injustices et aux défauts de la machine sociale, mais on peut dire, me semble-t-il, qu’un instrument d’ordre philosophique et culturel, une prise de conscience, une « découverte » concernant la réalité temporelle et la vie terrestre de l’homme a fait défaut alors à l’intelligence chrétienne pour juger spéculativement et pratiquement, — d’ailleurs à contre-courant de l’histoire, puisque la période en question est celle de la dissolution de la chrétienté, — les choses de la vie économique et sociale au point de vue de la réalisation sociale-temporelle de l’Evangile. Ce n’est pas l’esprit évangélique qui durant ce temps a manqué aux parties vivantes et saintes du monde chrétien, mais une conscience suffisamment explicite d’un des champs de réalité auxquels cet esprit doit s’appliquer. Si excessive que soit la prétention d’Auguste Comte d’avoir inventé la science du social, on peut penser à ce point de vue que les illusions « scientifiques » du sociologisme — et de même celles du socialisme — ont travaillé pour les enfants de lumière, en les contraignant à la « découverte » réfléchie de ce champ de réalité.
Ces considérations font mieux voir que l’état de culture des peuples chrétiens est encore extrêmement arriéré par rapport aux possibilités sociales du christianisme, et à la pleine conscience de ce que la loi évangélique réclame des structures temporelles de la cité. Elles nous aident aussi à comprendre comment des âmes bonnes et pieuses, qui mettent en pratique les maximes chrétiennes dans leur vie privée et dans les relations d’individu à individu, semblent soudain changer de plan et suivre les maximes du naturalisme quand elles ont à affronter cet ordre spécial de relations, cette réalité morale sui generis qui ressortit au social comme tel x. Enfin elles peuvent contribuer à nous expliquer que la transformation qui substitua peu à peu le régime du prêt à intérêt et du capitalisme au régime de l’économie médiévale, si elle a dès l’origine suscité pour l’intelligence du peuple chrétien maintes questions concernant la conscience individuelle et le confessionnal, n’ait pas, durant si longtemps, été pensée et jugée par cette intelligence (d’ailleurs éduquée de façon cartésienne) au point de vue de sa signification et de sa valeur proprement sociales : en sorte que le régime capitaliste a pu s’installer dans le monde en rencontrant la résistance passive et l’hostilité sourde des formations sociales catholiques, mais sans provoquer d’opposition active, délibérée, et efficace, de la part du monde chrétien ou du « temporel chrétien », même catholique.
Il importe toutefois de remarquer que la protestation de la conscience catholique n a pas manqué de se faire entendre. Au XIXe siècle en particulier, au temps même où le capitalisme arrivait à maturité et prenait possession du monde, des hommes ont élevé la voix, un Ozanam, un Vogelsang, un La Tour du Pin. Et surtout l’Eglise a suppléé elle-même aux déficiences du monde chrétien, en formulant les principes et les vérités supérieures qui dominent toute la matière économique, — et que le régime des peuples modernes méconnaît largement. Telle fut en ce domaine l’œuvre doctrinale de Léon XIII, à laquelle aujourd’hui fait écho celle de Pie XI. On sait que l’influence des interventions pontificales et des activités catholiques suscitées et orientées par elles a déjà été grande sur la législation et sur l’esprit public.
Or nous assistons actuellement à un événement historique dont 1 importance est considérable : ce qu’on pourrait appeler la diaspora chrétienne, j’entends la famille ou collectivité temporelle chrétienne disséminée parmi les nations, disons, si l’on veut, le « laïcat » chrétien, commence à prendre une conscience explicite, réfléchie, délibérée, à la fois de sa mission culturelle propre et de la réalité propre de l’univers social comme tel. Et dans l’instant que l’Église, ayant triomphé des crises de la première moitié du XIXe siècle, où elle luttait pour la vie et pour la liberté, reprend en main l’intellectualité chrétienne, cette prise de conscience se fait, à notre avis, et se fera de plus en plus contre le matérialisme capitaliste autant que contre le matérialisme communiste, qui n’en est que la conséquence. Si l’on réfléchit aux efforts laborieux et discordants de la pensée religieuse au XIXe siècle, aux inconvénients qu’elle a soufferts du fait qu’elle manquait de lumières philosophiques et théologiques assez hautes, et aux vérités que cependant elle a su magnifiquement affirmer, on est porté à croire qu’une des œuvres auxquelles notre époque est appelée sera de réconcilier la vision d’un Joseph de Maistre et celle d’un Lamennais dans l’unité supérieure de la grande sagesse dont Thomas d’Aquin est le héraut.
Ce n’est pas du point de vue du matérialisme historique et en vertu de thèmes marxistes comme la théorie de la plus-value, ou en récusant en principe la légitimité de la propriété privée, que 1 économie capitaliste doit être critiquée, c’est du point de vue des valeurs éthiques et spirituelles, au nom de la primauté sociale de la personne, et en tenant que la vie humaine est ordonnée à la conquête d’une authentique liberté d’autonomie. A ce point de vue, si considéré dans son principe abstrait ou selon son schème idéal, le type d’économie auquel se réfère le régime capitaliste n’est pas, comme le pensait Marx, fondamentalement illégitime, il faut dire, ainsi que j’ai essayé de le montrer ailleurs, que de fait, et considéré non seulement dans son mécanisme idéal, mais dans son esprit historique et dans la façon concrète dont cet esprit s’est incarné dans les structures de la vie humaine, ce régime est lié au principe contre nature de la fécondité de l’argent. « Au lieu d’être tenu pour un simple aliment servant à l’équipement et au ravitaillement matériels d’un organisme vivant qui est l’entreprise de production, c’est l’argent qui est tenu pour l’organisme vivant, et l’entreprise avec ses activités humaines pour l’aliment et l’instrument de celui-ci : en telle sorte que les bénéfices ne sont plus le fruit normal de l’entreprise alimentée par l’argent, mais le fruit normal de 1 argent alimenté par l’entreprise. Renversement des valeurs dont la première conséquence est de faire passer les droits du dividende avant ceux du salaire, et de placer toute l’économie sous la régulation suprême des lois et de la fluidité du signe argent, primant la chose biens utiles à l’homme. » (Religion et Culture, p. 98-99). Pour critiquer une telle économie c’est à une fille de Dieu dont la notion est exclue de tout système matérialiste, et dont pourtant les révolutionnaires matérialistes, sans oser se l’avouer à eux-mêmes, exploitent secrètement l’énergie, c’est à la sainte justice que le chrétien fait appel ; il n’est pas obligé, lui, par son système, de dissimuler l’idée de justice comme une chose dont on a honte ; il est libre de la mettre en pleine lumière ; elle est forte, elle mène loin.
Comme je l’écrivais dans un récent article (Esprit, janvier 1933), le catholicisme maintiendra toujours les principes et les vérités qui commandent toute culture, et protégera toujours tout ce qui, dans le monde actuel, subsiste encore de conforme à ces principes. Mais il semble bien qu’il s’oriente décidément vers de nouveaux types culturels. Le moment paraît venu pour le christianisme de tirer toutes les conséquences du fait que le monde issu de la Renaissance et de la Réforme a achevé de se séparer du Christ. Il n’a aucune solidarité à accepter à l’égard des principes de corruption qui travaillent un monde qu’on est fondé à regarder comme le cadavre de la chrétienté médiévale.
Pourtant la prise de conscience dont j ai parlé ne se produit elle pas trop tard ? Si la pensée chrétienne rassemble sa sagesse spéculative et pratique dans une sorte de libre et décisif épanouissement, est-ce pour offrir un tel don à des mains déjà pourrissantes, à un monde qui n’a plus la force de le recevoir ? Est-ce pour nous payer d’une consolation platonique, et de la seule pensée de ce qui aurait pu être ?
Il se peut que les comptes du présent monde soient trop lourds, et qu’il finisse mal. Mais la fin d’un monde n’est pas la fin du monde. Nous ne savons pas pour quel temps nous travaillons. Quand il serait vrai qu’une renaissance chrétienne vient trop tard dans le monde héritier de Luther, de Descartes et de Rousseau, c’est alors qu’elle viendrait trop tôt au regard d’un autre âge de culture. Il y aura encore des jours après la dissolution de ce monde-là, et des germinations nouvelles. Mais la vérité est que la liberté de l’homme a dans l’histoire une part plus grande et plus mystérieuse qu’il ne croit (en un sens, tout dépend de lui : qu’il soit libre d’abord, je dis en esprit, l’événement suit). Enfin, même à supposer que l’effort du chrétien sur
le monde actuel échoue dans l’ordre du profane comme tel ou du temporel comme fin (intermédiaire), nous sommes assurés qu’il n’échouera pas, si contrarié qu’il puisse être, dans l’ordre du temporel comme moyen ou instrument du spirituel, dans l’ordre de cette chrétienté spirituelle qui a « juste assez de corps pour retenir l’âme unie à lui », et qui passera toujours à travers le gros moyen qu’on lui opposera. Transiens per medium illorum, ibat…
J’ai montré dans l’étude publiée dans votre numéro de janvier pourquoi il faut distinguer ces deux ordres ou ces deux instances. Il serait absurde de prétendre sacrifier l’un à l’autre, c’est sur les deux à la fois que l’effort doit porter. Mais en vertu même des plus essentielles hiérarchies de valeurs, il faut reconnaître que l’ordre du « temporel pauvre » passe avant l’ordre du « temporel lourd », comme l’ordre du spirituel passe avant l’ordre du temporel tout entier. Si l’on méconnaît ces subordinations, on pèche contre cela même qu’on prétend défendre, on aggrave le mal.
La transformation que nous devons espérer est une révolution beaucoup plus profonde que celle dont fait état la littérature révolutionnaire ; car la révolution communiste est une crise par où la tragédie d’une civilisation ordonnée avant tout à la jouissance des biens terrestres et au primat de la matière atteint à son dénouement logique : les principes radicaux du désordre capitaliste sont exaspérés, non pas changés. Au lieu que pour le chrétien il s’agit de changer ces principes radicaux, cette orientation foncière de notre civilisation. En définitive c’est la transfiguration du monde qui est notre point de mire. Et pour autant que quelque chose d’une telle œuvre passe dans l’histoire, il est clair que pour autant c’est Dieu qui est alors l’agent principal ; et les hommes, rebelles ou consentants, des instruments.
Le problème qui, dès lors, s’impose à notre attention, si nous voulons être instruments à la manière des fils, non des esclaves, est celui de la purification des moyens. Nous devrons distinguer trois ordres incommensurables de moyens, qui ont chacun leur loi propre : les moyens temporels lourds, les moyens temporels pauvres, les moyens spirituels. Chacun de ces ordres est soumis pour sa part aux régulations de l’éthique chrétienne ; et la hiérarchie qui règne entre eux est inviolable. C’est par l’esprit que tout commence; les transformations temporelles s’originent au supra-temporel. Sur l’histoire elle-même du monde et des civilisations tombe le mot de Jean de la Croix : « C’est sur l’amour que vous serez jugés. »
J’ai employé tout à l’heure le mot révolution. Permettez-moi d’attirer votre attention sur la différence qu’il y a entre user d’un mot comme nom commun, ( une révolution, des révolutions), ou comme nom propre ou personnel (la Révolution). Dans le second cas le mot révolution se trouve chargé d’un sens historique bien défini et il fait partie de l’héritage d’une certaine famille d’hommes, de ceux qui ont voulu le plus ardemment instaurer le règne de l’humanisme anthropocentrique, et dont les communistes sont actuellement les représentants les plus typiques. Et il entraîne naturellement, du seul fait que la chose qu’il désigne a été ainsi hypostasiée, à faire de « la révolution », ou de « l’esprit révolutionnaire », la règle suprême des jugements de valeur et de l’action : il est clair (comme le faisait remarquer, si je me souviens bien, l’auteur d’une des réponses à l’enquête récemment faite par la N. R. F.) qu’on se subordonne, en ce cas, de gré ou de force, à ceux qui pour le moment, représentent le type pur de l’esprit révolutionnaire pris comme suprême valeur.
Que le monde soit entré dans une période révolutionnaire, c’est un fait qu’il n’y a qu’à constater. On est fondé à dire en conséquence qu’on est soi-même révolutionnaire, pour marquer qu’on entend se tenir au niveau de l’événement, et comprend la nécessité de transformations « substantielles » atteignant les principes mêmes de notre actuel régime de civilisation.
Mais les plus cachés et les plus efficaces de ces principes sont d’ordre spirituel. Et le mot révolution connote dans son imagerie les gros changements visibles et soudains, propres au monde de la matière. Si cette imagerie devait faire dériver la pensée et le désir vers le visible et le tangible, l’extérieur, le charnel, le rapide, (le facile), pris comme le plus important, et faire croire au primat des résultats immédiats et des moyens temporels lourds, il serait l’occasion d’une grande duperie. Les premiers soutiens de la révolution d’octobre, en Russie, ont été des intellectuels qui, voulant une « révolution spirituelle >’, ont pris pour le radicalisme des exigences de l’esprit le radicalisme d’un bouleversement visible et tangible masquant la catastrophe du vieux mal de l’esprit moderne ; Lénine s’est d’ailleurs débarrassé d’eux par des moyens expéditifs, après s’être servi d’eux.
Péguy disait que la révolution sociale sera morale ou ne sera pas. C’est se condamner à une œuvre avant tout destructive que vouloir changer la face de la terre sans d’abord changer son propre cœur, — ce que nul homme ne peut par lui-même. Et peut-être, si l’amour tout-puissant transformait vraiment nos cœurs, le travail extérieur se trouverai-il à moitié fait déjà.
Tout cela montre, me semble-t-il, qu’il vaut mieux être révolutionnaire que se dire révolutionnaire, surtout en un temps où la révolution est devenue le plus « conformiste » des lieux communs, et un titre réclamé par tout le monde. Se rendre libre de cette phraséologie serait peut-être un utile acte de « courage révolutionnaire ».
En tout cas, et pour revenir au thème essentiel de cette lettre, la rupture entre l’ordre chrétien et le désordre établi n’intéresse pas seulement les choses économiques ou politiques, mais tout l’ensemble de la culture, les relations du spirituel et du temporel, la conception même qu’on doit se faire de l’œuvre de l’homme ici-bas et en ce temps de l’histoire du monde. Elle n’intéresse pas seulement le régime extérieur et visible de la vie humaine ; elle intéresse aussi et en premier lieu les principes spirituels de ce régime. Elle doit se manifester à l’extérieur, dans l’ordre visible et tangible. Mais la condition inéluctable est qu’elle se conforme d’abord dans l’intelligence et dans le cœur de ceux qui veulent être les coopérateurs de Dieu dans l’histoire, et c’est qu’ils en comprennent toute la profondeur.
Jacques Maritain
«Notre Église est l’Église des saints» (Bernanos)
Georges Bernanos hacia 1940
Georges Bernanos: «Notre Église est l’Église des saints» (1929)
(Final de la obra de G. Bernanos: Jeanne, relapse et sainte. Paris: Plon, 1929. En G. Bernanos: Essais et écrits de combat. Paris: Gallimard, 1971, pp. 40-42).
L’heure des saints vient toujours. Notre Église est l’Église des saints. Qui s’approche d’elle avec méfiance ne croit voir que des portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Eglise est l’Eglise des saints. Pour être un saint, quel évêque ne donnerait son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal sa pourpre, quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses suisses et tout son temporel ? Qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure ? Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure. Qui l’a une fois compris est entré au cour de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Eglise est l’Eglise des saints. Mais qui se met en peine des saints ? On voudrait qu’ils fussent des vieillards pleins d’expérience et de politique, et la plupart sont des enfants. Or l’enfance est seule contre tous. Les malins haussent les épaules, sourient : quel saint eut beaucoup à se louer des gens d’Eglise ? Hé ! Que font ici les gens d’Eglise ! Pourquoi veut-on qu’ait accès aux plus héroïques des hommes tel ou tel qui s’assure que le royaume du ciel s’emporte comme un siège à l’Académie, en ménageant tout le monde ? Dieu n’a pas fait l’Eglise pour la prospérité des saints, mais pour qu’elle transmît leur mémoire, pour que ne fût pas perdu, avec le divin miracle, un torrent d’honneur et de poésie. Qu’une autre Eglise montre ses saints ! La nôtre est l’Eglise des saints. A qui donneriez-vous à garder ce troupeau d’anges ? La seule histoire, avec sa méthode sommaire, son réalisme étroit et dur, les eût brisés. Notre tradition catholique les emporte, sans les blesser, dans son rythme universel. Saint Benoît avec son corbeau, saint François avec sa mandore et ses vers provençaux, Jeanne avec son épée, Vincent avec sa pauvre soutane, et la dernière venue, si étrange, si secrète, suppliciée par les entrepreneurs et les simoniaques, avec son incompréhensible sourire, Thérèse de l’Enfant-Jésus. Souhaiterait-on qu’ils eussent tous été, de leur vivant, mis en châsse ? assaillis d’épithètes ampoulées, salués à genoux, encensés ? De telles gentillesses sont bonnes pour les chanoines. Ils vécurent, ils souffrirent comme nous. Ils furent tentés comme nous. Ils eurent leur pleine charge et plus d’un, sans la lâcher, se coucha dessous pour mourir.
Quiconque n’ose encore retenir de leur exemple la part sacrée, la part divine, y trouvera du moins la leçon de l’héroïsme et de l’honneur. Mais qui ne rougirait de s’arrêter si tôt, de les laisser poursuivre seuls leur route immense ? Qui voudrait perdre sa vie à ruminer le problème du mal, plutôt que de se jeter en avant ? Qui refusera de libérer la terre ? Notre Eglise est l’Eglise des saints. Tout ce grand appareil de sagesse, de force, de souple discipline, de magnificence et de majesté n’est rien de lui-même, si la charité ne l’anime. Mais la médiocrité n’y cherche qu’une assurance solide contre les risques du divin. Qu’importe ! Le moindre petit garçon de nos catéchismes sait que la bénédiction de tous les hommes d’Eglise ensemble n’apportera jamais la paix qu’aux âmes déjà prêtes à la recevoir, aux âmes de bonne volonté. Aucun rite ne dispense d’aimer. Notre Eglise est l’Eglise des saints. Nulle part ailleurs on ne voudrait imaginer seulement telle aventure, et si humaine, d’une petite héroïne qui passe un jour tranquillement du bûcher de l’inquisiteur en Paradis, au nez de cent cinquante théologiens. « Si nous sommes arrivés à ce point, écrivaient au pape les juges de Jeanne, que les devineresses vaticinant faussement au nom de Dieu, comme certaine femelle prise dans les limites du diocèse de Beauvais, soient mieux accueillies par la légèreté populaire que les pasteurs et les docteurs, c’en est fait, la religion va périr, la foi s’écroule, l’Eglise est foulée aux pieds, l’iniquité de Satan dominera le monde !…» et voilà qu’un peu moins de cinq cents ans plus tard l’effigie de la devineresse est exposée à Saint-Pierre de Rome, il est vrai peinte en guerrière, sans tabard ni robe fendue !, et à cent pieds au-dessous d’elle, Jeanne aura pu voir un minuscule homme blanc, prosterné, qui était le pape lui-même.
Notre Eglise est l’Eglise des saints. Du Pontife au gentil clergeon qui boit le vin des burettes, chacun sait qu’on ne trouve au calendrier qu’un très petit nombre d’abbés oratoires et de prélats diplomates. Seul peut en douter tel ou tel bonhomme bien pensant, à gros ventre et à chaîne d’or, qui trouve que les saints courent trop vite, et souhaiterait d’entrer au paradis à petits pas, comme au banc d’ouvre, avec le curé son compère. Notre Eglise est l’Eglise des saints. Nous respectons les services d’intendance, la prévôté, les majors et les cartographes, mais notre cour est avec les gens de l’avant, notre cour est avec ceux qui se font tuer. Nul d’entre nous portant sa charge, (patrie, métier, famille), avec nos pauvres visages creusés par l’angoisse, nos mains dures, l’énorme ennui de la vie quotidienne, du pain de chaque jour à défendre, et l’honneur de nos maisons, nul d’entre nous n’aura jamais assez de théologie pour devenir seulement chanoine. Mais nous en savons assez pour devenir des saints. Que d’autres administrent en paix le royaume de Dieu ! Nous avons déjà trop à faire d’arracher chaque heure du jour, une par une, à grand-peine, chaque heure de l’interminable jour, jusqu’à l’heure attendue, l’heure unique où Dieu daignera souffler sur sa créature exténuée, Ô Mort si fraîche, ô seul matin ! Que d’autres prennent soin du spirituel, argumentent, légifèrent : nous tenons le temporel à pleines mains, nous tenons à pleines mains le royaume temporel de Dieu. Nous tenons l’héritage des saints. Car depuis que furent bénis avec nous la vigne et le blé, la pierre de nos seuils, le toit où nichent les colombes, nos pauvres lits pleins de songe et d’oubli, la route où grincent les chars, nos garçons au rire dur et nos filles qui pleurent au bord de la fontaine, depuis que Dieu lui-même nous visita, est-il rien en ce monde que nos saints n’aient dû reprendre, est-il rien qu’ils ne puissent donner ?
El movimiento Esprit y la revolución espiritual (Mounier)
Emmanuel Mounier leyendo la revista Esprit
Emmanuel Mounier: «El movimiento Esprit y la revolución espiritual» (1934)
(Cruz y Raya, 15/2/1934, nº 11, pp. 2-14)
“¿Hasta cuándo nuestro Estado, que tiene ya tantos oficios, que fabrica cerillas y fabrica leyes, que fabrica transportes por ferrocarril y reglamentos de administración pública, y todo eso, no sin pena ni sin cierto embarazo, que se le notan demasiado; hasta cuándo nuestro Estado seguirá sin dejar en paz definitivamente las conciencias, sin comprender que no es misión suya fabricarnos también una metafísica? ¿Cuándo, al fin, el Estado, fabricante de cerillas y de contravenciones, comprenderá que no es cuenta suya el hacerse filósofo y metafísico?”
(De Charles Péguy: Cahiers de la Quinzaine, VIII-5, du 2 décembre 1906.)
* * * * *
El movimiento Esprit ha sido creado por un grupo de jóvenes resueltos que, ante la quiebra del mundo moderno, tratan de buscar y establecer, sobre la primacía de lo espiritual, los asientos de un orden humano.
Nuestra rebeldía ha partido de tres constataciones fundamentales:
Primera.— La existencia y la tiranía de lo que hemos llamado un desorden establecido.
Este desorden no es pasajero, ni es solamente económico, sino que está arraigado en el corazón del hombre, y es espiritual en su origen.
El hombre concreto se ha desvanecido tras una cortina nebulosa de abstracciones. El hombre social está ahogado por el individualismo y fortificado en el atrincheramiento múltiple de los egoísmos colectivos. Al hombre espiritual le ha sido quitado su sustento; el ideal de la santidad ha caído bajo el ideal pequeñoburgués. Así, vaciado, es el hombre moderno la complaciente presa del mundo del dinero. Allí adquiere ese espíritu burgués de sórdida avaricia y de vida mezquina que ha invadido hoy a todas las clases de las sociedades y ha dejado el campo abierto al despertar de todas las barbaries primitivas.
Este desorden no está solamente en los corazones. Se ha consolidado en un desorden establecido: usando, con imprevistas fuerzas, de la libertad económica que le había sido concedida como un anejo de la libertad política, y esta vida económica pronto se hizo una guerra general. La refriega se ha hecho todavía más sabia, anónima y mortífera por la furia de la producción y la presa de la finanza sobre la economía, que han señalado el primer cuarto del siglo XX. Después vino el desorden político: el dinero, dueño de lo económico, ha sojuzgado el poder político, apoderándose de los dos grandes órganos de la democracia: la prensa y el parlamento. Sólo el dinero gobierna los cuerpos y las almas: hoy toda democracia es un engaño.
Es fácil comprender la gravedad de este desorden cuando a uno le toca directamente; más difícil cuando a uno no le afecta. Pero si se vencen las repugnancias de la imaginación a esas excitaciones que nos cierran el mundo tanto como el odio, nadie puede dejar de aceptar su parte de mala conciencia, porque los que no son culpables por sus iniciativas lo son por la complicidad de su silencio y de su inercia.
Segunda.— El desorden establecido compromete y desvía en provecho propio los valores espirituales a los cuales nos sentimos más vivamente unidos.
En el campo político, aquellos que dicen: alma, persona, amor, religión, han sido reclutados, en todos los países, allí donde los intereses económicos y las fuerzas pasivas de reacción gustan implantar sus doctrinas y encontrar a sus hombres. Es esta una traición con la que han hecho a los valores espirituales solidarios de su hipocresía, enajenándoles el corazón de las masas.
Y aún hay algo más grave. Para doblegarlos a su interés, fabricaron imágenes gesticulantes y las lanzaron, imponiéndolas, a la circulación corriente. Defendieron, como libertad, dejar el campo libre a todas las fuerzas de opresión; como propiedad, los caminos ilícitos para adquirir bienes y la repartición injusta que es su consecuencia; como familia y patria, no se sabe qué hoscas ciudadelas o qué alertas casas comerciales; como religión, una tapadera para sus intereses y la coartada para asegurarse una conciencia tranquila en la injusticia. Toda una moral, toda una cultura, toda una teología han sido edificadas sobre estas caricaturas, y aparecen hoy, a los ojos de muchos, como la moral, como la cultura, como la teología. Hay que atravesar, que romper esa costra de mentiras y malentendidos para llegar a nuestra obra de restauración.
Tercera.— Al mismo tiempo que el desorden establecido alcanza su apogeo, asistimos hoy a una crisis natural de las formas de la civilización contemporánea. Toda carne se gasta, se endurece y muere. Los valores eternos deben cambiar periódicamente de cuerpo para salvaguardar su misma eternidad y su espiritual permanencia. Ahora bien, todas las instituciones, todos los conceptos de nuestra vida, están, en su mayor parte, desde hace un siglo, montados sobre las estructuras del mundo de la máquina y en desacuerdo con cuanto este mundo lleva consigo de nuevas formas de agrupación humana, de repartición del poder, de práctico acortamiento del espacio y del tiempo. Hay que proceder, pues, a un ajuste. Y es el espíritu quien debe tomar la iniciativa, trazar las direcciones.
¿Qué debe hacerse?
Algunos pretenden aceptar ese mismo mundo que juzgan malo, transformándolo mediante insensibles reformas, al amparo del falso pretexto de la continuidad de la Historia; ignoran que el espíritu, que conduce el mundo, procede bajo la luz de lo absoluto por rechazos heroicos, por contragolpes, por compromisos totales y por la autoridad de la fe; sin este ímpetu en su marcha, el mundo se apoltronaría en la digestión de todas las buenas intenciones, sobre todo cuando el mal ocupa los puestos de mando. Otros se evaden por los itinerarios del lujo, y toman como vestido de lo espiritual el gusto de una distinción cuyo principal precio, a sus ojos, está en que les aparta; por los itinerarios jansenistas de la desesperación, desde donde, retirados en una elevada vida interior, y sin encontrar en ella la presencia de la ternura, dejan al mundo ir, librándose de él por cóleras, lamentaciones o deslumbramientos apocalípticos; por los derroteros, en fin, de una revolución puramente interior, y aun introvertida, que les apacigua la conciencia, ordenando sus conceptos, pero sin que esto les comprometa hasta llegar a un verdadero sacrificio de sí mismos.
Contra el reformismo y contra esas evasiones hemos preconizado una actitud de revolución espiritual. ¿Qué quiere decir esto?
Revolución. No se trata de violencia en las calles, destinada al fracaso ante las armas modernas; tampoco creemos en el advenimiento de una edad de oro en que la humanidad, cambiando de sentido, se afiance en la beatitud conquistada; no creemos en la necesidad para la Historia de negarse a sí misma y trastornarse continuamente, ni en la fatalidad, por la madurez de los procesos económicos, de los frutos dialécticos. Somos revolucionarios en el doble sentido de que el espíritu, en su esfuerzo heroico hacia la perfección constante, lucha contra la esclerosis de la vida, y que la descomposición del mundo moderno está, a estas fechas, tan avanzada, que su derrumbamiento es necesario para la aparición de nuevos brotes.
Pensamos, además, que los cambios superficiales, por sorprendentes que parezcan, pueden encubrir, al pasar de un régimen a otro, una profunda continuidad de principios; que una revolución que no es, por de pronto, una revolución espiritual, no es más que un cambio de decoración, un engaño del que pronto aparecerán las flaquezas. Porque los cambios técnicos, incluso radicales, son insuficientes, y es que hace falta volver a tomar las cosas en su misma raíz humana: en el corazón del hombre y en el de las instituciones. Algunos toman pretexto de esta necesidad de revolucionar los corazones para no actuar, esperando el reino universal de la perfección. No nos dejamos engañar por esta hipocresía: la revolución espiritual, a nuestro entender, debe comprometernos más y llevarnos más lejos que las revoluciones técnicas o políticas más alborotadas.
Revolución espiritual, por de pronto; pero también revolución temporal, y más completa, precisamente porque empieza siendo espiritual.
La revolución será moral o no será, y este principio define nuestra revolución por sus fines y por sus medios.
Nuestra revolución tiene un fin. No nos es dada por un proceso necesario, y bueno porque es necesario, tal como la revolución marxista. Hoy no hay ya que preguntar: “¿Es usted revolucionario?” (todo el mundo contestaría que sí), sino “¿por qué es usted revolucionario?” ¿Por qué?, es decir: amando ¿qué? No queremos una revolución de salvación capitalista. No queremos una revolución anticapitalista por principio, pero capitalista a su pesar, por sus móviles y su ética: generalización del confort, de la riqueza, de la seguridad, de la consideración: por ahí se han aburguesado los movimientos revolucionarios y han venido a satisfacer los fascismos las más mediocres aspiraciones. No queremos una revolución de la desesperación, que dimite a los hombres responsables en el servicio ciego de un salvador. Queremos a los hombres libres, responsables, libertados del dinero y sus tiranías exteriores e interiores. En nombre de este ideal y de las más elevadas posibilidades espirituales que para cada cual implica, les llamamos a sacudir esa servidumbre.
La revolución espiritual no puede acudir a cualquier medio. Nos aplicamos a definir una técnica de medios puramente espirituales que surgen de la acción de presencia y de la radiación explosiva de la santidad, y, asimismo, a trazar las reglas que se imponen en el empleo de los medios de fuerza.
Falta definir de qué espíritu nos declaramos.
Muchos asimilan hoy el despertar del espíritu a una reacción de las energías vitales contra los mecanismos y las torpezas de un mundo decadente: juventud, deporte, disciplina, conquista de la materia, exaltación heroica; he aquí cómo se presentan los fascismos a los corazones fatigados de deserciones repetidas. Pero reprochamos precisamente a los fascismos ese pseudoespiritualismo que, no contento con dejar intactos los fundamentos del capitalismo, con desviar el movimiento proletario bajo la dirección del Estado-Partido totalitario, de entregar a los hombres responsables en las manos de una autoridad incontrolada, desvía el renacimiento espiritual hacia la idolatría tiránica de las espiritualidades inferiores: culto de la raza, de la nación, de la fuerza, del jefe, de la disciplina anónima, de los trabajos públicos y de los resultados deportivos.
Identifican otros el espíritu con la cultura que distingue y separa. Pero la cultura no vale más que por su contenido. Separada de toda vida interior, hace del hombre un espejo pasivo que refleja indiferentemente todos los aspectos del mundo, sin dar a ninguno su amor. Primacía de lo espiritual no significa en manera alguna primacía de lo intelectual. Tanto más cuanto que toda cultura está encarnada, y el intelectual de hoy lleva, casi siempre, los estigmas del mundo burgués. Cuando se acude a la defensa de la cultura, es frecuentemente en defensa de la cultura burguesa a lo que uno se precipita: nuestros bienes no son de ese mundo.
Sí, el espíritu es todavía libertad. Pero libertad orientada y sacrificada, preparada y mantenida por una necesaria constricción material sobre las tendencias anárquicas. Hay ilusorias libertades que tiranizan a quienes las gozan y libertades mortíferas que abren la puerta a la opresión.
Estas delimitaciones y estas exclusiones nos parece que definen una familia de hombres para la cual la vida espiritual es la dedicación íntima a una realidad que desborda los valores vitales y culturales; familia de hombres que pone la entrega de sí mismo a la cabeza de todos los valores prácticos, y, que, de suyo difusiva, tiende a animar hacia la perfección el conjunto de la vida privada y social de cada uno. Sería hoy criminal no hacer que trabajasen en común los hombres que juntos pueden construir tantas cosas. Pero hemos de precisar que su agrupación no implica, en modo alguno, que acepten entre ellos una confusión con todo lo exterior, que han desechado, sino que, por el contrario, lleve allí cada uno su personalidad entera con sus diferencias y sus riquezas propias.
Entre nosotros, mayormente, hay muchos que son cristianos. Nombran al Espíritu con cierto Nombre; traen a la vida espiritual un cierto número de determinaciones. Nadie habría de exigirles disminución alguna de sí mismos por una especie de pudor o reserva. Solamente que lleven, en toda su pureza, el mensaje que se les ha confiado, que se desolidaricen de sus compromisos con el desorden establecido, que tomen conciencia de su deber de iniciativa en cuanto a la organización de la tierra, sin ligar su fe a ninguna de las soluciones provisionales que pudieren aportar.
Respetadas estas diferencias, si se nos pregunta cuáles son las grandes líneas mentales que nos dirigen, respondemos:
El espíritu es persona. Pero existe un vínculo indisoluble entre el desenvolvimiento de la personalidad y el desenvolvimiento de la comunidad. Nuestra revolución será a la vez personalista y comunitaria.
La amistad humana quedó rota en el Renacimiento.
El individualismo ha esterilizado progresivamente la búsqueda de la persona. En reacción contra él, hoy rompe sobre el mundo una inmensa ola de colectivismo, que ella misma tiende a desviarse hacia una concepción mecánica de la masa, dirigida contra la persona. Tenemos que rehacer el primer Renacimiento y lograr el segundo; tenemos que transcender sobre las abstracciones inhumanas de un cierto individualismo y de un cierto colectivismo (capitalista, fascista, comunista) para reanudar el vínculo vivo de la persona y de la comunidad. Por un lado, nos hace falta volver a encontrar, bajo el individuo avaro, la persona, que no es simplemente un engranaje bien adaptado del organismo social, sino un centro de libertad, de meditación y de amor; una relación original, señora de su destino. Paralelamente, tenemos la experiencia de que no se puede establecer una relación social con un agregado de células anónimas, a no ser insuflándoles alguna pasajera embriaguez: no hay comunidad viviente si no es una comunidad de personas libres y diversas hasta lo infinito. Liberar a la persona, acudir, para engrandecerla, a esa gran corriente colectiva que nace en torno nuestro: he aquí la tarea que tenemos como propia.
A partir de tales principios, se descompone nuestra obra en una obra de depuración, una obra de meditación y una obra de construcción.
La obra de depuración consiste en denunciar, allí donde se encuentre, la traición y la explotación de los valores espirituales, singularmente por el mundo del dinero. Obra en verdad urgente en una época en que los hombres no saben; obra profética indispensable en una época en que los hombres no se comprometen.
La obra de meditación consiste en disociar en nuestros valores corrientes el alma duradera y viviente de la parte impura o caduca que nuestras repetidas traiciones inscriben hasta en las palabras. Es esta una obra de vida interior tanto como de análisis intelectual.
Estas dos primeras obras pueden ser consideradas como preliminares. Son permanentes, lo mismo que las fuerzas de desviación, y no son negativas (según se dice a veces) si la rectitud interior es la condición de toda creación durable.
De la obra de construcción no podemos indicar más que las grandes líneas.
Conforme a los principios más arriba expuestos, nos preguntaremos, acerca de toda transformación posible, y antes de adoptarla, en qué medida favorece, de una parte, la expansión de la personalidad; de otra, el desenvolvimiento de la comunidad. Nos hará falta establecer comunidades allí donde hoy no existen, y para defenderlas contra su propio peso, descentralizarlas hasta la persona.
Nuestra obra básica debe ser el desenvolvimiento de la persona, condición de toda sociedad.
Esto implica que se haga posible, a cada uno, una vida personal; vida interior, vida de descanso, vida artística, conversación poética con el mundo, que hoy la miseria impide o el aburguesamiento esteriliza en la mayoría. Implica también que esta vida ha de ser enteramente entregada a sus vías propias, auxiliada tan sólo en lo que toca a descubrir esa libertad misma, y que una orientación comenzada desde la infancia, con el auxilio de todas las competencias espirituales y técnicas, contribuya a despertar a cada hombre a su vocación y aquijarle hacia la vida que le asegure no el máximo rendimiento, sino la expansión máxima.
Se apoya, en segundo lugar, sobre las experiencias modestas y ricas de la vida privada. Mediante una vida privada libre de burguesas avaricias, de atmósferas confinadas, de los artificios del dinero y de la consideración, es como salvaremos al hombre de los verbalismos y de las mentiras de la vida pública moderna. Hemos de volverle a enseñar lo que son el amor, la amistad, la camaradería, la familia.
Más allá del hogar, de la vida personal y de la vida privada, el hombre se inserta en el juego complejo de la comunidad, cuya alma nos hace falta rehacer.
Es la primera la comunidad profesional, injerta en el trabajo. No es el trabajo todo, ni siquiera lo esencial en la actividad humana: tanto como contra un pesimismo que le niega toda alegría y toda dignidad, hemos de reaccionar contra la religión del trabajo, de origen burgués (Franklin, Ford), y adoptada, no se sabe bajo el efecto de qué aberración, por los movimientos obreros. Ni adoramos el esfuerzo, ni el rendimiento, ni la riqueza y la consideración que derivan de ellos.
El trabajo es, para cada uno, el medio de ganar su vida; tiene esta dignidad y ninguna otra.
Las nuevas condiciones hechas para la profesión son el desenvolvimiento del maquinismo, la organización y la educación progresiva de los trabajadores. El primero debe conducir a la progresiva disminución de la jornada de trabajo, absorbiendo como absorbe la máquina continuamente el automatismo que ella misma ha creado. Se crea así una ancha zona abierta al trabajo cualitativo libre y al enriquecimiento de las horas vacantes. La elevación de los trabajadores desde el anonimato del proletariado oprimido hasta la conciencia personal, la educación técnica que en esas sus nuevas horas vacantes podrán pedir a los sindicatos, debe facilitarles el acceso, según modos que habrán de determinarse, a la cooperación en la gestión de las empresas, realizando así una democracia industrial orgánica. Se hace indispensable para esta revolución institucional un enderezamiento del sindicalismo, agotado en agitaciones políticas, en el reformismo de Estado o en las reivindicaciones de la semana corta.
Se integra el trabajo en una vida económica más vasta que la empresa. Funciona esta actualmente bajo los principios capitalistas: fecundidad del dinero, primacía del provecho, como móvil animador de la economía, primado de la producción o tiranía, anárquica o concertada, de una oligarquía del dinero, y opresión, por la abstracta finanza, de la vida económica concreta.
Nuestra economía se inspira en principios diametralmente opuestos. Economía humana, regulará la producción sobre el consumo, desenvolverá en el trabajador —productor— otros móviles que no sean el del provecho por el enriquecimiento y la estimación, singularmente el sentido del servicio, y la voluntad del desenvolvimiento personal; suprimirá la especulación, todas las formas de la usura y la libertad anárquica del crédito.
Creemos en el valor espiritual del vínculo de propiedad personal que liga a un creador con su obra, a condición de que este poder sea despojado de avaricia y dirigido hacia el bien de todos. Sin embargo, la producción moderna no realiza, sino muy raramente, el caso del hombre aislado frente a su propia obra, y ha de realizarle cada vez menos, ya que el bien común impone la eliminación del despilfarro. El objeto producido debe pertenecer, en tales condiciones, a la copropiedad de todos los que en su elaboración participaron. Por otra parte, la centralización económica ha creado organismos tan poderosos, de tan general interés, que no es posible abandonarles al capricho de los particulares. Para salvaguardar todos esos valores de iniciativa, de libre y fecundo trabajo, que hemos reconocido como esenciales, estas consideraciones deben conducir a una colectivización parcial de la economía. Colectivización no sistemática, quizá amplia, quizá estrecha —eso lo decidirán las condiciones técnicas y la salvaguarda del hombre—; colectivización no estatista, sino remitida, con amplia descentralización, a los grupos corporativos regionales y comunales (municipales).
El Estado no tiene un poder totalitario sobre las personas y los grupos. Debe suscitar, coordinar, respaldar las iniciativas personales o colectivas interesadas en el bien común. Adversarios del parlamentarismo abstracto, incompetente e impotente frente a las fuerzas económicas, lo somos igualmentedel estatismo fascista y del estatismo comunista, que asfixian al hombre bajo la centralización material y bajo la dictadura espiritual. Pensamos que el problema de las relaciones entre la democracia y la autoridad debe ser planteado de nuevo enteramente. La potencia económica, hoy escondida y excéntrica, debe ser reintegrada en el poder político, pero distinta de él: este debe ser la representación de todos los intereses concretos y de todas las agrupaciones espontáneas. Cuando así hayamos restituído su ser a la democracia, deberemos devolverla el poder de decisión mediante una técnica de las relaciones entre la ejecución y la consulta.
La patria es un valor complejo, a la vez carnal y espiritual, con frecuencia tan local como nacional. Lo que ella representa de realidad viviente está radicalmente desviado por el mito abstracto de la nación y de su soberanía. La colaboración internacional no ha de nacer ni de un internacionalismo sin más contenido que un ente de razón, ni de un parlamentarismo de gobiernos esterilizados por su soberanía y por su impotencia ante las verdaderas fuerzas del mundo. Un reino de injusticia estará siempre dividido contra sí mismo. Si la pendiente actual de los espíritus conduce a cada país a recogerse sobre sí mismo y a purificar sus fuerzas vivas, debemos convencer a cada cual de que el reino del dinero es el reino de la guerra, y que el problema internacional es, ante todo, un problema social e interior.
Junto a las revoluciones comunista y fascista, hoy se debe el occidente a sí mismo el renegar todos sus yerros y el buscar en sus propios manantiales el mensaje que el mundo en gestación espera de él. A nosotros nos toca mostrar que el espíritu es, por de pronto, un poder de perpetua resurrección.
«Los vivos y los muertos» (Maragall)
Joan Maragall en 1903
Joan Maragall: “Los vivos y los muertos” (Diario de Barcelona, 1/11/1911)
Esta Conmemoración anual de los Difuntos es como una corona lanzada en ofrenda al más allá por encima del muro de obscuridad que nos rodea y que nos va sorbiendo uno tras otro, sin que ninguno vuelva a decir lo que pasa al otro lado ni nos dé señal de ello. […] Hermanos nuestros sois los millones que lo habéis pasado: ayer erais como nosotros mismos, y sabéis nuestro afán, que era el vuestro propio. Aquí nos habéis dejado golpeando el muro y queriendo ablandarlo con nuestras lágrimas para sentir algo al través, y nada contestáis: aunque hayáis sido aquí nuestro amor más fuerte, y nosotros el vuestro, nada queréis decirnos. ¿No podéis? […] Tal vez nos llamáis a gritos y no podéis haceros oír de nosotros […]
Tal vez nuestro error está en considerar la otra vida como cosa demasiado distinta y apartada. Algo de nuestra humanidad habrá aun en ella ¿no os lo dice el corazón? Y eternidad hay en todas, y nuestra fe no es tan ciega como exasperadamente la pintamos. Momentos de eternidad sentimos ya en nosotros mismos. Ante la naturaleza, ante los grandes afectos humanos, ante Dios directamente en la oración, tenemos momentos de luz, de exaltación, de alegría, con una gran paz al mismo tiempo, en que todo lo de este mundo nos es igual; es el puro goce del ser de cualquier modo, es la vida eterna.
Pues no busquéis más: esto es lo que os espera, un poco más claro tal vez, si lo habéis merecido, al otro lado del muro, y en ello todos vuestros muertos. Y si os ejercitáis bien en esto ya del lado de acá, si tales momentos de eternidad se multiplican y dilatan tanto en vuestra vida actual que ya lo demás de ella sea lo de menos, el muro que nos rodea se irá adelgazando, adelgazando, y sutilizándose y dejándose penetrar hasta que vacile y caiga.
«Carta a una señora» (Maragall)
Joan Maragall en 1903
Joan Maragall: “Carta a una señora” (Diario de Barcelona, 9/11/1911)
Usted va siempre por extremos, señora; pues así me reprende por místico y despreciador de esta vida a poco que yo insista en su valor espiritual orientándola hacia el más allá, como me niega la hermosura que Dios ha puesto en ella y que nos deja presentir su buen fin, aun en medio del mal y del dolor que le son inseparables, En el primer caso me exhorta a tratar con gran atención y preferencia los intereses materiales, la salud del cuerpo, el bienestar y las riquezas que pueden procurarnos la satisfacción de muchas necesidades y apetitos; en el segundo se revuelve usted contra toda tolerancia del mal y aceptación del dolor, y casi llega a la conclusión de que esta vida es un mal en sí y de que más valiera no haber nacido. Y a mi me parece usted tan pagana en el primer caso como en el segundo, No absolutamente pagana en ninguno de los dos, porque bien conozco la firmeza de su adhesión a la fe cristiana y cómo se aplica a templar uno y otro estado de su espíritu con las prácticas religiosas que de aquella se derivan; pero sí relativamente pagana en cuanto dicha adhesión y sus prácticas más parecen en usted una actitud violenta de defensa contra los asaltos de aquel espíritu de paganismo que siente vivir en usted bien a su pesar, que no un natural y efusivo despliegue de un sentido verdaderamente cristiano de la vida.
[…] Tal como ha llegado a nosotros, esa contraposición entre Dios y el mundo, induce a muchos hombres y a muchas mujeres a creer necesaria cierta opción entre la vida religiosa y la vida mundana; o si no, en una alternación entre una y otra. […] Esa escisión a mí me parece que es fuente de muchos males porque es precisamente la negación del espíritu del Evangelio. Es un error funesto del cual hemos de pedir continuamente a Dios y a su Iglesia que nos libren.
Esta escisión es la que induce a creer al hombre que vive de su trabajo, que todo esto de dios es cosa de curas y beatas; es la que induce al acumulador de millones y placeres a creerse en paz con Dios con donar en vida o en muerte un millón para un asilo o para un templo […] Y Dios, sin embargo, quiere entrar en el trabajo penoso, y en los millones del banquero (esto es, en el modo de tomarlos y de darlos en el mundo mismo), y en el dolor que nos aguarda en casa, y en el placer de partir el pan de cada día a nuestros hijos, y en el trato que damos a nuestros amigos y nuestros enemigos, y en el ejercicio de nuestra profesión, y en todo puede Dios esta, en todo lo del mundo.
[…] De modo que esta contraposición entre Dios y el mundo no estará sino hasta donde nosotros queramos. En cualquier parte de él donde nosotros queramos recibir a Dios, allí estará Dios y cesará la contraposición. Si sé usar de mi placer de tal modo que en él quepa Dios, en aquella parte de mi mundo estará Dios y ya no será enemiga suya; y si sé ponerlo en mi dolor, allí estará; en mi lucro, allí estará, en mi tedio, en mi flojedad, en mi desesperación, y cada una de estas cosas dejará de ser tal al unirse con Dios, Así se unifica la vida, así se hace el mudo amigo de Dios, así muere la contraposición entre lo terrenal y lo eterno, haciéndose uno en Dios.
Y todo lo demás, sin esto, a mi me parece paganismo, o una actitud violenta de defensa por adhesión superficial a la fe y a sus prácticas.
Así me he esforzado de persuadir a usted, señora, de que cuando digo que la vida es hermosa no debe usted tomarme por un epicúreo; y de que cuando digo de orientarla hacia su más allá, no debe usted tomarme por un asceta; y de que cuando digo que todo es uno, tampoco debe tomarme por un panteísta. Porque yo sólo quiero ser cristiano, y como conozco me que falta mucho para ello, me esfuerzo en vivir cuanto puedo en Cristo; y como siento la solidaridad de las almas y me parece ver muchas dormidas, quisiera despertar alguna.
«La panacea» (Maragall)
Joan Maragall en 1903
Joan Maragall: “La panacea” (Diario de Barcelona, 16/11/1911)
Esta distinción que solemos hacer tan terminante entre el cuerpo y el alma, es hija de la soberbia de nuestra razón que todo quiere reducirlo a sus pobres mecanismos y considerarlo dentro de las categorías bien deslindadas que le son precisas y a las que, sin embargo, escapa la vida en la inmensa riqueza de aquel misterio que es la mayor y mejor parte de ella.
Así, por ejemplo, solemos juzgar y decir con el mayor aplomo: –Para los males del cuerpo, el médico; para los males del alma, el director espiritual; para el cuerpo, medicina; para el alma, máximas, consejos, reflexión. Pero yo me atrevo a preguntaros: –¿estáis seguros de saber bien lo que en vosotros es cuerpo y lo que es alma? […] Yo creo que mientras vivimos en nuestra vida actual el cuerpo y el alma forman una unidad que no se puede desconocer sin grave daño: llamemos a esta unidad cuerpo animado o alma encarnada, lo mismo da, con tal que no la rompamos queriendo considerar cada cosa por su lado.
Cuando bañamos y purificamos y entonamos esto que queremos llamar exclusivamente nuestro cuerpo en el agua, cuando lo ungimos y vestimos y adornamos, yo creo que también lo que llamamos nuestra alma queda purificada y entonada, y ungida y vestida y adornada en mucho, y que si lo hiciéramos con perfecta conciencia e intención de la integridad de nuestra persona, es decir, dejando toda el alma en el cuerpo, aquélla quedaría tan bañada y adornada como éste, porque en tal caso, esto es, presidiendo el acto tal conciencia e intención de unidad, no son cuerpo y alma, cosa y cosa, sino una sola.
Lo mismo digo de cuando se promueve en nosotros un gran bien espiritual, que si entonces sabemos incorporarlo a nuestra unidad: es decir, que si sabemos orar con los nervios y con los músculos y con la sangre, todo esto que llamamos cuerpo queda igualmente mejorado. […] Bien sabéis de cómo un enfermo se ha mejorado con sólo haberse trasladado del lugar donde enfermó a su casa; o por la simple presencia de una persona muy querida, o por una noticia buena.
Pues yo creo que el beneficio promovido por estos hechos exteriores puede lograrse igualmente, y mucho más, con un acto interior, con un esfuerzo de conciencia de nuestra unidad personal, con una invocación a aquella cosa invulnerable, pacífica, eterna, que sentimos latir en el fondo de nuestra naturaleza, a aquello que es nuestra casa de eternidad, que es un infinito de amistad siempre presente, que es una buena noticia que nos está llegando si constantemente la escuchamos; es aquel sentirse seguro en la mano de dios, sano o enfermo, en dolor o en descanso, muerto o vivo; aquella paz indestructible que no hay dolor, ni enfermedad, ni muerte, que pueda turbar; aquella cosa buena que nadie, nadie, ninguna criatura de Dios puede dejar de sentir si bien se atiende a sí mismo, porque está en la masa de lo que hemos sido hechos. Y aquella cosa, entonces, no hay sino avivarla en la conciencia de ella, no hay sino como acurrucarse uno y meterse todo en ella, para sentir cómo nos abriga y nos modela y nos vuelve a hacer en ella de modo que sentimos la vida afluir otra vez y, poco a poco, subir como una marea, invadiendo, difundiéndose por nuestros miembros hasta reintegrarnos en la sanidad y el vigor de todos ellos. Y si entonces nuestra naturaleza no consiente tanto, es igual, el beneficio no se pierde, estamos seguros de encontrarlo en otra parte.
Pero en éste “es igual”, en el anticipado goce de este beneficio, en esta seguridad de “la otra parte” está precisamente la mayor eficacia para conservarnos en ésta. En tal indiferencia está la mayor posibilidad, porque cuanto más todo nos es uno, más fácil colocación hallamos en cualquier cosa. Cuanto más, recogiéndome en mí mismo, digo: “Ya estoy muerto”, más vida siento en mí, porque entonces, en el fondo, de mi conciencia conozco que, del todo muerto, nunca podré estarlo; que ante la sola potencia de eternidad que se deja sentir en nosotros, con ser nuestra medida tan pequeña todavía para ella, la muerte es ya, sin embargo, una palabra vana.
Esta me parece que ha de venir a ser una resultante ideal de sentirnos bien unos en cuerpo y alma dentro de nuestra naturaleza; y no estar, como ahora, tan torpes, que creamos que son dos cosas enemigas que hay que servir por separado. Y así, cuando por tratar de servir al alma mortificamos innecesariamente al cuerpo, la ira de éste se siente en el alma misma porque ¿qué otro órgano tiene aquí el alma para su función? ¿Qué más alma tengo aquí sino este cuerpo? ¿Con qué ojos veo esta puesta de sol que resplandece delante de mi ventana y me inunda de sentir, de eternidad, con qué nervios la siento, con qué cerebro la ideo, con qué corazón late en todo mi ser, sino con estos ojos, con estos nervios, con este cerebro y con este corazón de mi cuerpo, de este cuerpo que con tales usos se hace alma?
[…] También es muy torpe y ridículo el otro extremo de los que atienden tanto a su cuerpo con regalos, con afeites y con drogas, que llegan a olvidar su naturaleza verdadera […] Tan preocupados están en conservar en buen estado el martillo, que no les queda tiempo para batir el hierro. Y entonces yo pregunto: ¿para qué un martillo tan bonito? Que tampoco es tan bonito, porque las cosas no se embellecen ni mejoran sino en su propio trabajo. Tratad de usar el cuerpo como alma y el alma como cuerpo y estaréis en algo de la unidad de su naturaleza y en su trabajo más propio, y por tanto es la única salud y belleza de toda ella.