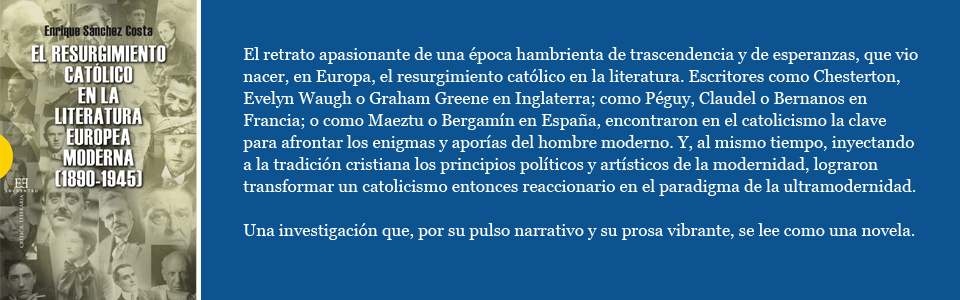Inicio » Catolicismo y arte
Archivo de la categoría: Catolicismo y arte
Novela y catolicismo (Mauriac)
François Mauriac recibiendo el Premio Nobel de Literatura en 1952
François Mauriac: Le Roman (1928)
(En Mauriac: Œuvres romanesques et théâtrales complètes, II. París: Gallimard, 1979, pp. 751-772. Fragmentos)
Le romancier est, de tous les hommes, celui qui ressemble le plus à Dieu : il est le singe de Dieu. Il crée des êtres vivants, il invente des destinées, les tisse d’événements et de catastrophes, les entrecroise, les conduit à leur terme. […]
Mais cette logique terrible qui pousse notre monde sans Dieu à considérer l’amour ainsi qu’un geste comme un autre, voilà pour le roman la plus grave menace. […]
C’est que l’histoire d’une société amorphe ne peut être récrite indéfiniment, comme l’étaient par nos prédécesseurs les conflits de l’esprit et de la chair, du devoir et de la passion. […]
Et sans doute, ce qu’ont osé faire certains romanciers d’aujourd’hui : ce regard jeté sur les plus secrets mystères de la sensibilité, cela sans doute est grave – d’une gravité qu’a mieux que personne comprise et exprimée Jacques Maritain dans quelques lignes qui posent le problème en toute clarté. J’extrais cette page de son étude sur J.-J. Rousseau parue dans un livre intitulé Trois réformateurs : “ Rousseau nous vise, non à la tête, mais un peu au-dessous du cœur. Il avive n nos âmes les cicatrices mêmes du péché de nature, il évoque les puissances d’anarchie et de langueur qui sommeillent en chacun de nous, tous les monstres qui lui ressemblent… Il a appris à notre regard à se complaire en nous-mêmes et à se faire le complice de ce qu’il voir ainsi, et à découvrir le charme de ces secrètes meurtrissures de la sensibilité la plus individuelle, que les âges moins impurs abandonnaient en tremblant au regard de Dieu. La littérature et la pensée modernes, ainsi blessés par lui, auront beaucoup de peine à retrouver la pureté et la rectitude qu’une intelligence tournée vers l’être connaissait autrefois. Il y a un secret des cœurs qui est fermé aux anges, ouvert seulement à la science sacerdotale du Christ. Un Freud aujourd’hui, par des ruses de psychologie, entreprend de le violer. Le Christ a posé son regard dans les yeux de la femme adultère et tout percé jusqu’au fond ; Lui seuil le pouvait sans souillure. Tout romancier lit sans vergogne dans ces pauvres yeux, et mène son lecteur au spectacle ”. (C’est le fin du primer chapitre de l’étude sur Rousseau, dans ce livre de Maritain).
Je ne sais rien de plus troublant que ces lignes pour un homme à qui est départi le don redoutable de créer des êtres, de scruter les secrets de cœurs. Je me sépare sur un point de Jacques Maritain : rien ne me semble pus injuste que de charger un seul homme d’une telle responsabilité. […]
La postérité de Balzac, et en particulier le plus illustre de ses fils, notre maître Paul Bourget, a étudié l’homme en fonction de la famille et de la société. Ces écrivains se sont fait de leur métier une idée très haute. Ils ont voulu servir la collectivité, la cité ; toute la puissance de leur art est tournée contre l’individu. […]
Nous sommes affligés aujourd’hui dune incapacité redoutable pour enrôler notre art au service d’une cause, aussi sublime fût-elle ; nous ne concevons plus une littérature romanesque détournée de sa fin propre qui est la connaissance de l’homme. […]
Reconnaissons que jamais autant qu’à l’école de M. Taine, ne régnèrent en philosophie comme en littérature, les généralités, les affirmations no prouvées ; asservi à la théorie fameuse de la race, du milieu et du moment, jamais on n’eut si peu le sens, le goût de la chose, telle qu’elle est, jamais on ne se soucia moins de saisir l’individu dans sa réalité, ni de l’étudier comme un être particulier, unique. M. Léon Brunschvicg, dans un récent article sur la littérature philosophique du XIXe siècle, citait cette singulière profession de foi de Taine, extraite de son discours de réception à l’Académie :
“ Par bonheur, disait Taine, autrefois comme aujourd’hui, dans la société il y avait des groupes, et, dans chaque groupe, des hommes, semblables entre eux, nés dans la même condition, formés par la même éducation, conduits, par les mêmes intérêts, ayant les mêmes besoins, les mêmes goûts, les mêmes mœurs, la même culture et le même fond. dès que l’on en voit un, on voit tous les autres ; en toute science, nous étions chaque classe d’objets sur des échantillons choisis ”.
On ne saurait pousser plus loin le mépris des différences individuelles sur quoi repose le roman d’aujourd’hui ; et M. Léon Brunschvicg a beau jeu d’opposer à Taine cette seule ligne de Pascal : “ À mesure qu’on a plus d’esprit, on trouve qu’il y a plus d’hommes originaux ”. C’est dans ce sens que notre génération réagit violemment contre l’école de Taine – dans un sens où il semble bien que nos cadets doivent aller encore plus loin que nous. Nos cadets –, et aussi quelques-uns de nos aînés : les dernier ouvrages de M. Henry Bordeaux témoignent, dans cette direction, d’un renouvellement profond. […]
La préoccupation d’être humain, le désir de ne rien laisser échapper de toutes les réalités de l’homme, voilà je crois les sentiments qui nous dominent tous, aînés et cadets. Oui, la connaissance de l’homme ; et aussi frappés que nous soyons par l’avertissement solennel de Maritain, rien ne nous détourne d’aller de l’avant. […] Ces mystères de la sensibilité, dont Maritain nous adjure de détourner notre regard, Proust nous enseigne que c’est par eux que nous atteindrons le tout de l’homme. […]
Mettre en lumière le plus individuel d’un cœur, le lus particulier, le plus distinct, c’est à quoi nous nous appliquons. […]
Et sans doute, ce n’est pas cela seulement que nous voulons saisir dans ce cœur, puisque notre ambition est de l’appréhender dans sa totalité ; et ici apparait une autre tendance très nette du roman moderne, et qui l’oppose au roman issu de Balzac ; nous souhaiterions ne pas introduire dans l’étude de l’homme une logique qui fût extérieure à l’homme ; nous craignons de lui imposer un ordre arbitraire. […]
Dostoïevski ne leur impose aucun ordre, aucune logique autre que cette logique de la vie qui du point de vue de notre raison est l’illogisme même. […]
Et ici sans doute touchons-nous au point essentiel : le problème qui se pose chez nous à l’écrivain d’imagination, c’est de ne rien renier de la tradition du roman français, et pourtant de l’enrichir grâce à l’apport des maîtres étrangers, anglo-saxons et russes, et en particulier de Dostoïevski. Il s’agit de laisser à nos héros l’illogisme, l’indétermination, la complexité des êtres vivants ; et tous de même de continuer à continuer à construire, à ordonner selon le génie de notre race, – de demeurer enfin des écrivains d’ordre et de clarté…
Le conflit entre ces deux exigences : d’une part, écrire une œuvre logique et raisonnable – d’autre part, laisser aux personnages l’indétermination et le mystère de la vie – ce conflit nous paraît être le seul que nous ayons vraiment à résoudre. […]
C’est parce qu’il a vu dans ses criminelles et dans ses prostituées des êtres déchus mais rachetés, que l’œuvre du chrétien Dostoïevski domine tellement l’œuvre de Proust. Dieu est terriblement absent de l’œuvre de Marcel Proust, ai-je écrit un jour. Nous ne sommes point de ceux qui lui reprochent d’avoir pénétré dans les flammes, dans les décombres de Sodome et de Gomorrhe ; mais nous déplorons qu’il s’y soit aventuré sans l’armure adamantine. Du seul point de vue littéraire, c’est la faiblesse de cette œuvre et sa limite ; la conscience humaine en est absente. Aucun des êtres qui la peuplent ne connaît l’inquiétude morale, ni le scrupule, ni le remords, ni ne désire la perfection. Presque aucun qui sache ce que signifié : pureté, ou bien les purs, comme la mère ou comme la grand-mère du héros, le sont à leur insu, aussi naturellement et sans effort que les autres personnages de souillent. Ce n’est point ici le chrétien qui juge : le défaut de perspective morale appauvrit l’humanité créée par Proust, rétrécit son univers. La grande erreur de notre ami nous apparaît bien moins dans la hardiesse parfois hideuse d’une partie de son œuvre que dans ce que nous appellerons d’un mot : l’absence de la Grâce. À ceux qui la suivent, pour lesquels il a frayé une route vers des terres inconnues et, avec une patiente audace, fait affleurer des continents submergés sous les mers mortes, il reste de réintégrer la Grâce dans ce monde nouveau. […]
Il n’est pas un romancier – fût-il audacieux, et même plus qu’audacieux – qui, dans la mesure où il nous apprend à nous mieux connaître, ne nous rapproche de Dieu. Jamais un récit, ordonné out exprès pour nous montrer la vérité du christianisme, ne m’a touché. Il n’est permis à aucun écrivain d’introduire Dieu dans son récit, de l’extérieur, si j’ose dire. L’Être Infini n’est pas à notre mesure ; ce qui est à notre mesure, c’est l’homme ; et c’est au-dedans de l’homme, ainsi qu’il est écrit, que se découvre le royaume de dieu.
Un récit qui veut être édifiant, fût-il l’œuvre d’un excellent romancier, nous laisse l’impression d’une chose arrangée, montée de toutes pièces, avec le doigt de Dieu comme accessoire. Au contraire, nul ne peut suivre le Chéri de Colette ni atteindre, à travers quelle boue ! ce misérable divan où il choisit de mourir, sans comprendre enfin, jusqu’au tréfonds, ce qui signifie : misère de l’homme sans Dieu. Des plus cyniques, des lus tristes confessions des enfants de ce siècle monte un gémissement inénarrable. Aux dernières pages de Proust, je ne peux plus voir que cela : un trou béant, une absence infinie.
Qu’est-ce d’abord qu’un chrétien ? C’est un homme qui existe en tant qu’individu ; un homme qui prend conscience de lui-même. L’Orient ne résiste, depuis des siècles, au Christ parce que l’Oriental nie son existence individuelle, aspire à la dissolution de son être, et souhaite de se perdre dans l’universel. Il ne peut concevoir que telle goutte de sang ait été versée pour lui, parce qu’il ne sait pas qu’il est un homme.
C’est pourquoi la littérature, en apparence la plus hostile au christianisme, demeure sa servante. […].
Les humanistes ont hâté, sans le vouloir, le régné du Christ, en donnant à l’homme la première place. Ils ont assigné la première place à la créature qui porte partout, sur son visage auguste, dans son corps, dans sa pensée, dans ses désirs, dans son amour, l’empreinte du Dieu tout-puissant. Le plus souillé d’entre nous ressemble au voile de Véronique et il appartient à l’artiste d’y à l’artiste d’y rendre visible à tous les yeux cette Face exténuée. […]
Le romancier peut et doit tout peindre, dit quelque part Jacques Maritain, à condition qu’il le fasse sans connivence et qu’il ne soit pas avec son sujet en concurrence d’avilissement. Là réside justement le problème. On ne peint pas de haut des créatures avilies. Elles doivent être plus fortes que leur créateur, pour vivre. Il ne les conduit pas ; c’est elles qui l’entraînent. S’il n’y a pas connivence, il y aura jugement, intervention et l’œuvre sera manquée. Il faudrait être un saint… mais alors, on n’écrirait pas de roman. La sainteté, c’est le silence. Impossible d’exorciser le roman, d’en chasser le diable (à moins de le prendre par les cornes, comme a fait Bernanos).
Et sans doute, malheur à l’homme par qui le scandale arrive. Un écrivain catholique avance sur une crête étroite entre deux abîmes : ne pas scandaliser, mais ne pas mentir ; ne pas exciter les convoitises de la chair, mais se garder aussi de falsifier la vie. […]
Maritain y las vanguardias: «Réponse a Jean Cocteau»
Jean Cocteau en 1926: cuando se produjo el intercambio epistolar con Maritain
Jacques Maritain: «Réponse a Jean Cocteau» (1926)
(En Jean Cocteau: Lettre à Jacques Maritain / Jacques Maritain: Réponse à Jean Cocteau. París: Stock, 1964, pp. 81-130. Fragmentos)
Que suis-je ? Un converti. Un homme que Dieu a retourné comme un gant. Toutes les coutures dehors, l’écorce est à l’intérieur, elle ne sert plus a rien. Un tel animal a de la peine à s’estimer quelque chose, il a envie de demander pardon aux autres d’exister. […] Vous comprenez cela, vous, bien que pour vous le cas n’ait pas été de quitter l’hérésie pour la foi, mais seulement de reprendre votre banc à l’église. […]
Toujours vous avez eu souci des Anges. Vous parler d’eux dans tous vos livres. […] De son côté ma philosophie était tout occupée d’eux. Elle était entrée dans la traité des Anges conduite par le docteur Angélique. […]
Votre esthétique de la corde raide rejoignait sans peine la théorie scolastique de l’art. Avec une sagacité qui m’enchantait, vous formuliez pour la poésie (cachée sous la musique) les grandes lois de purification et dépouillement qui commandent toute spiritualité, celle de l’œuvre à faire comme celle de la vie éternelle à atteindre, et qui ont leur souverain analogué (mais transcendant et surnaturel) dans l’ascèse et la contemplation. Vous ne vouliez de la poésie que la poésie à l’état pur, le pur démon de la grâce agile, la pure agilité de l’esprit. […]
L’erreur homicide par excellence, c’est de vouloir se guérir de l’humain par les moyens de l’homme, – ou de l’animal, ou de la plante. Elle circule dans toutes les fausses mystiques, et se matérialise dans l’opium, où elle prend forme végétale : le pavot à la place du Paraclet. L’opium est le plus pervers quand il se donne pour véhicule d’une vie spirituelle, et prétend mener à ce vide que Dieu seul peut produire. Quiétisme en pilules, sacrement du démon. […]
Le Seigneur est généreux, sa grâce éclate comme une grenade, et d’un coup fait plusieurs victimes. Il n’a pas voulu que vous revinssiez seul dans sa maison. Deux baptêmes, bientôt doublés eux-mêmes, une vocation au sacerdoce, d’autres grâces encore, ont suivi votre rencontre avec Jésus. […]
Entre le monde de la poésie et celui de la sainteté il y a un rapport d’analogie, je prends ce mot dans toute la force que lui donnent les métaphysiciens, avec tout ce qu’il signifie pour eux et de parenté et de distance. Toutes les erreurs viennent de ce qu’on ne sait pas voir cette analogie, les uns enflent la similitude, ils brouillent la poésie et la mystique, les autres l’exténuent, ils font de la poésie un métier, un art mécanique.
Elle est d’en haut cependant, non pas comme la grâce, qui est essentiellement surnaturelle, et nous fait participants de ce qui est propre à Dieu seul, mais comme la plus haute ressemblance naturelle de l’activité de Dieu. Notre art, disait Dante, est le petit-fils de Dieu. Et non seulement il dérive comme de son pur archétype de l’art qui a fait le monde, mais pour avoir quelque idée de sa noblesse il faut évoquer le mystère de la procession du Verbe : car l’intelligence comme telle est féconde, où elle ne peut produire un autre soi-même comme en Dieu, elle veut au moins engendrer une œuvre, fait à notre image et où survive notre cœur.
Il y a une inspiration d’ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles, et qui présuppose la charité, elle élève les âmes saintes au mode surhumain d’agir qui fait la vie mystique. Mais dans l’ordre naturel aussi il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison, et qui procède, comme le notait Aristote, de Dieu présent en nous. Telle est l’inspiration du poète. C’est pourquoi il est bien un homme divin. Comme le saint ? Non. Comme le héros : δίος Σκτωφ. […]
Les mots, les rythmes, ne sont pour lui qu’une matière. Avec eux il crée un objet qui fasse la joie de l’esprit, où brille quelque reflet de la grande nuit étoilée de l’être. Ainsi il perçoit dans les choses et délivre un signe, si infime qu’il soit, de la spiritualité qu’elles détiennent, son regard d’aveugle rencontre au sein du créé le regard de Dieu. […]
Elle est donc une image de la divine grâce. Et elle-même, parce qu’elle décèle les allusions répandues dans la nature, et parce que la nature est une allusion au royaume de Dieu, elel nous donne, sans le savoir, un pressentiment, un désir obscur de la vie surnaturelle. Je me rappelle le mot de Baudelaire : “ C’est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau ”. Et il ajoutait : “ Quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d’un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d’une mélancolie irritée, d’une postulation des nerfs, d’une nature exilée dans l’imparfait et qui voudrait s’emparer immédiatement sur cette terre même, d’un paradis révélé ”. […]
Tout cela pourtant au service d’un bien qui n’est pas le Bien. De tous les chefs-d’œuvre ensemble, on n’en saurait tirer un mouvement de charité. Nous donnerions, Jean, tous les poèmes et tous les systèmes, pour le petit repos d’amour, invisible mêma au regard naturel des anges, d’un cœur uni à dieu.
Même à l’égard du péché l’art imite encore la grâce. Qui ne connaît pas les régions du mal ne comprend pas grand-chose à cet univers. Si le stoïcien les ignore (il ne croit pas au diable), le saint les connaît bien. La tentation l’instruit. […] Comme il fait partie de l’univers du christianisme, où il constitue l’occasion propre d’un des sacrements, le péché fait partie de l’univers de l’art. Mais c’est pour une fausse rédemption. Avec lui l’art fait une œuvre, il en tire de la beauté : mais beauté d’une matière morte. Illusionniste, il transfigure le mal, il ne le guérit pas. […]
L’art lui-même va spontanément à Dieu. A Dieu non comme fin de l’homme, non dans la ligne morale. A Dieu comme principe universel de toute forme et de toute clarté. Dès qu’il atteint dans sa ligne propre un certain niveau de grandeur et de pureté, il annonce sans les comprendre l’ordre et la gloire invisibles dont toute beauté n’est qu’un signe. […]
Et n’ayez crainte, mon cher Jean, le scandale ne saurait manquer. Toujours ce qui est de Dieu a fait scandale. Oui, observons la démarche de Jésus : “ Passant au milieu d’eux, il allait ”. Le monde a été sauvé par un scandale par amour dont la Synagogue n’est pas encore revenue, et dont le bruit ne passera pas. […]
J’ai dû commencer par la controverse, elle m’ennuie de plus en plus. Je sais les erreurs qui ravagent le monde moderne, et qu’il n’a de grand que sa douleur, mais je respecte cette douleur ; je vois partout des vérités captives, quel Ordre de la Merci se lèvera pour les racheter ? […]
Qu’on ne dise pas, parce que nous échangeons ces lettres, que nous prétendons annexer, vous ma philosophie à votre poésie, moi votre poésie à ma philosophie. Nous prétendons seulement qu’elles peuvent s’aimer tout en restant libres. […]
Beaucoup de ceux qui se croient nos ennemis sont en réalité plus près de nous qu’ils ne pensent et que nous ne pensons. Ils désirent avec une force admirable ce même Dieu que nous aimons, que nous n’aimons pas assez. Si nous l’avions aimé davantage ne le connaîtraient-ils pas ? De la religion ils ne connaissent qu’une vague caricature cartésienne, ils n’y voient que pratiques sans signification, morale confortable. Le monde moderne leur a enseigné que Dieu s’élaborait dans l’homme, il a renversé l’ordre, fait l’acte pur dépendant de nous. Des prémisses qu’on leur a apprises ils ont au moins le mérite de tirer la conclusion : Désespoir. Hélas, ils cherchent Dieu dans la destruction d’eux-mêmes. L’instinct de leur âme immortelle, l’instinct même du baptême jadis reçu par la plupart, les jette vers un absolu qu’ils croient devoir inventer, ignorant qu’il est là, plus intime à eux qu’eux-mêmes, car c’est lui qui les a faits. Un saint leur tend les bras, qui a trouvé ce qu’ils cherchent : de la fausse nuit du somnambule seule peut les guérir la nuit de saint Jean de la Croix.
Meudon, janvier 1926
Claudel: «Religion et Poésie»
Paul Claudel en 1929
Paul Claudel: «Religion et Poésie» (1927)
(Conferencia pronunciada por Claudel en Baltimore, el 14 de diciembre de 1927. En Claudel: Œuvres en prose. Paris: Gallimard, 1965, pp. 58-64).
Mon sujet est la poésie française et les raisons pour lesquelles je pense qu’elle devrait être plus intimement associée avec la religion qu’elle ne l’a été dans le passé.
Catholique veut dire universel, et le primer article du Credo nous apprend que l’univers est fait de deux parties, les choses visibles et les choses invisibles. Des choses invisibles nous sommes instruits par les lumières de la raison et de la foi. Des choses visibles nous sommes instruits par les lumières de la raison, de l’imagination et des sens. Ces choses sont très bonnes suivant leur ordre. La raison est bonne. L’imagination est bonne. La sensibilité est bonne. Seuls des hérétiques, ou des jansénistes comme Pascal, peuvent croire qu’aucune faculté de cet esprit humain qui a été créé par Dieu, est mauvaise en soi. Il n’y a que le désordre et l’abus qui soient mauvais. Les choses visibles ne doivent pas être séparées des choses invisibles. Toutes ensemble constituent l’univers de Dieu et ont entre elles des relations claires ou mystérieuses; l’Apôtre nous dit en effet que par les unes, nous sommes conduits à la connaissance des autres. La science ne s’occupe que des choses visibles. Son affaire est d’aller de l’effet à la cause, d’une chose matérielle à une autre chose matérielle, du fait à la mesure. Son domaine est ce que les choses sont, non pas ce que les choses signifient. Des facultés humaines, elle n’utilise que la raison, raison nourrie par la mémoire et stimulée par l’imagination. C’est un pouvoir de constatation, ce n’est pas un pouvoir de création.
La science essaye de classer, de systématiser et d’utiliser ce qui est autour de nous et pour cela elle n’a pas besoin de mettre en jeu toutes les facultés de l’esprit humain, de l’âme et du corps, de l’intelligence et du cœur. C’est fort différent, de voir une chose ou de la faire. Et le domaine propre de l’art et de la poésie est, comme ce dernier mot l’indique, de faire. De quelque chose qui était simplement perçu par les sens, l’homme fait quelque chose que la raison peut comprendre et dont la sensibilité peut jouir, d’une chose matérielle il fait un être spirituel. En donnant au mot sa pleine signification pour notre esprit et pour nos sens, la poésie est, comme vous dites en anglais, le pouvoir qui réalise pleinement les êtres, qui en fait des réalités. Pour connaître une chose vous n’avez qu’à comprendre ce qu’elle est, mais pour faire une chose vous avez à comprendre comment elle est faite. Et pour comprendre comment elle est faite vous devez comprendre en vue de quoi elle a été faite, quelles sont ses relations avec les autres êtres, et quelle a été l’idée de celui à l’origine qui a tout fait. Vous ne comprenez pas une chose, vous n’avez aucun moyen de vous en servir convenablement, si vous ne comprenez pas ce qu’elle était appelée à signifier et à faire, si vous ne comprenez pas sa position, dans la communauté générale des choses visibles et invisibles, si vous n’en avez pas une idée universelle, si vous n’en avez pas une idée catholique.
Bien sûr, même sans une idée générale de la terre et du ciel, vous pouvez faire de la très jolie poésie, vous pouvez ciseler de délicates œuvres d’art, vous pouvez combiner des bibelots fort curieux et intéressants. Mais dans cette poésie païenne, il y a toujours à mon avis quelque chose d’étriqué et de gêné. Même pour le simple envol d’un papillon le ciel tout entier est nécessaire. Vous ne pouvez comprendre une pâquerette dans l’herbe, si vous ne comprenez pas le soleil parmi les étoiles.
La poésie française pendant les XVIIe et XVIIIe siècles a été simplement un moyen concis, spirituel et harmonieux d’exprimer des pensées. C’était une façon de parler en proverbes et sentences frappantes, un peu à la manière des gens de la campagne. Au XIXe siècle c’était bien de la vraie poésie, mais c’était de la poésie sans Dieu. Beaucoup de poètes français du XIXe siècle avaient du talent et même du génie, mais ils n’avaient pas la foi. Et si leur œuvre fait à certains l’effet d’un amas de décombres, je voudrais vous montrer que la cause de ce rapide déclin n’est pas qu’ils manquaient de talent, mais qu’ils manquaient de religion, c’est-à-dire qu’à leur talent et à leurs œuvres manquait un ingrédient essentiel.
Pour illustrer ce que j’avance je vais prendre quelques-uns des thèmes, ou, comme nous disons, des « motifs », de la poésie française — et je pourrais tout aussi bien dire de la poésie anglaise — pendant le XIXe siècle. Le meilleur de ces thèmes, parce qu’il est fondé en toute vérité sur la nature humaine, est celui de la révolte. Aussi longtemps qu’il y aura de l’injustice en ce monde la révolte est un sentiment qui trouvera un large et profond écho dans les âmes humaines. C’est un sentiment parfaitement naturel et nous pouvons même dire que c’est un sentiment légitime. Nous savons tous qu’après tout l’Homme a quelque chose à dire pour sa défense. Dans ce livre merveilleux où l’Église a pris les neuf leçons de l’Office des Morts, Job parle à son Créateur tout à fait librement et sans crainte et quand ses amis épouvantés essayent de l’arrêter, le Dieu Tout-Puissant lui-même leur dit : Vous êtes des sots ; laissez l’Homme exposer sa cause à son aise. Ainsi la meilleure poésie du XIXe siècle est une poésie de révolte. Mais après tout la révolte a de grands inconvénients artistiques. Elle ne conduit nulle part. Elle vous laisse exactement au même point où vous étiez en commençant. Et comme elle est vaine elle est fatigante et elle devient vite ennuyeuse. Elle nous excite à vide. En outre les meilleurs thèmes poétiques sont ce que j’appelle des thèmes qui composent, des thèmes qui, comme la nature, ont besoin pour s’exprimer d’une grande variété d’éléments. Eh bien, la révolte n’est pas un thème qui compose. Elle ne fait pas les choses s’accorder, parce que son but n’est autre que la discorde. Un cri perçant de protestation peut toucher le cœur, il ne fera jamais une harmonie.
Parents du thème de la révolte sont le désespoir et le cynisme, tous deux largement mis à contribution par la poésie du dernier siècle : de bons vers ou des vers tolérables ont été faits dans cette veine de sentiment. Mais ils prêtent à la même critique. Le désespoir est une disposition passagère. L’âme humaine n’a pas été faite pour lui. Le cynisme est quelquefois amusant, mais il est camelote et nous en sommes rapidement rassasiés. Nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne pouvons pas bâtir quelque chose avec des matériaux comme la révolte, le désespoir, le nihilisme, le cynisme et toutes ces idées purement négatives.
Et ici je me permettrai une petite remarque. Quand la liberté de penser a été conquise au début du siècle dernier, quand furent brisées les vieilles chaînes du dogme et de la superstition, il aurait été naturel de s’attendre à un vrai débordement de joie. Un homme qui au bout de longues années de captivité recouvre la liberté se sent généralement fou de joie. Or n’est-il pas frappant de constater que dans toute la poésie du XIXe siècle la joie fait défaut ? Vous trouvez parfois une jouissance grossière des plaisirs les plus bas, mais quand vous cherchez de la joie vous ne trouvez que désespoir, blasphèmes, nostalgie de la pureté perdue et regret des chaînes brisées. A mon avis le plus grand poète du XIXe siècle est Baudelaire parce qu’il était très intelligent et comprenait très bien où il en était. Oui, Baudelaire est le plus grand poète du XIXe siècle parce qu’il est le poète du Remords. En un siècle la poésie française a refait l’expérience de tout le paganisme et est passée des rêves sauvages de la Révolution et du romantisme au nihilisme, au matérialisme et au complet désespoir de ces années qui ne sont pas très éloignées de la présente.
Mais, nous dit-on, en dehors de la religion, il y a aussi des thèmes constructifs. Eu voici un par exemple : l’immortalité de l’âme, chacun le sait, a été controuvée par la « science ». Après la mort l’âme disparaît entièrement comme une bouffée de fumée, mais n’est-ce pas une pensée consolante que notre cher corps subsiste dans le vent, dans le soleil, dans les fleurs et dans les petits oiseaux ? Vous connaissez ce thème. Il a donné naissance à des océans de mauvais vers, parce que vous ne pouvez pas faire de la bonne poésie avec une idée sotte. Ce thème n’est pas bon ni partiellement bon, il est niais. Deux minutes de réflexion suffisent à nous montrer que, même si la matière survit, nous- mêmes ne survivons pas, ce qui, après tout est la seule chose importante. Ce n’est pas la même chose si la Vénus de Milo survit en tant que statue ou en tant que pavés. Ce n’est pas la même chose si une rose survit en tant que rose ou en tant qu’engrais.
Prenons un autre thème soi-disant constructif : l’Evolution. Je ne parle pas de l’Evolution comme doctrine scientifique. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse, cela m’est égal, et, personnellement, je n’y crois pas, parce que rien ne peut être deux choses en même temps. Je ne la considère ici que comme une idée poétique, comme une invitation pour l’esprit à composer quelque chose. A première vue l’Evolution apparaît comme une idée stimulante et pleine de promesses parce qu’elle implique le changement et ouvre libre cours à la fantaisie. Je suppose que l’Evolution a été d’un grand secours pour les romanciers, et d’ailleurs je pense personnellement que la plupart des livres sur l’Evolution ne sont rien de plus que du roman et des contes de fée de seconde zone. Mais ce que les poètes proprement dits ont essayé de faire avec l’Evolution n’a pas été un succès. Je me rappelle plusieurs complexes à la fois didactiques et épiques que de pauvres croyants mal guidés mais bien intentionnés comme René Ghil ou Louis Bouilhet ont essayé d’écrire sur les aventures de Frère Diplodocus dans le pays de Lias. Le résultat fut épouvantable. J’ai moi-même essayé un jour de proposer à mes enfants comme thème de devoir de vacances une adresse de félicitations présentée par tous les animaux à Sœur Girafe le jour où, après de longs âges d’efforts fossiles, elle réussit à ajouter seize vertèbres à son épine dorsale. Je pourrais vous la lire. Mais je ne voudrais pas décourager parmi vous certaines ambitions, parfaitement légitimes, de même ordre girafique. L’Evangile nous a dit, il est vrai, que nous ne pouvions ajouter une coudée à notre taille. Mais saint Matthieu est sur bien pauvre personnage à côté de M. Wells ou simplement de Darwin et de Lamarck.
Pour revenir à mon sujet, je pense que l’Evolution est un mauvais thème, parce qu’un poète aime à prendre au sérieux toutes les choses qui l’entourent. Il ne les considère pas comme des esquisses provisoires appelées à être promptement supplantées par des créations battant neuves. Il les considère comme des figures de l’éternité, figures pleines de joie, de leçons inépuisables et d’une immense importance. Il ne voit rien à changer en elles, il déteste l’idée de les voir changer. L’Eternité ne lui suffirait pas à les comprendre. La nature pour lui est comme un homme qui dit et redit toujours la même chose, comme si ce quelque chose était d’une importance considérable. C’est toujours la même rose et la même violette et ce sera toujours la même rose et la même violette parce que dès l’origine elles ont été très bonnes, valde bona, et ne peuvent être meilleures. Elles peuvent seulement, rose ou violette, devenir mieux ce qu’elles sont. Je pourrais vous indiquer beaucoup d’autres thèmes de poésie ainsi ruinés et démodés. Il est assez attristant de voir combien peu de temps il faut pour qu’une mode nouvelle se fane et devienne ridicule. Rappelez-vous ce qu’il est advenu de Tolstoï, de Nietzsche, d’Ibsen. Même dans les drames de Wagner quand Erda commence à émettre des oracles nous ne pouvons réprimer un sourire et un bâillement. La poésie de Wagner est comme le Rhin qui coule parmi les vieux « burgs », des châteaux démantelés ou, ce qui est plus triste encore, restaurés au goût Kaiser Wilhelm. Les « fabriques » font de la peine, mais le Rhin à leurs pieds coide toujours. Il n’y a pour les choses et pour les poèmes qu’une seule manière d’être nouveaux, c’est d’être vrais, et qu’une seule manière d’être jeunes, c’est d’être éternels.
Et ceci m’amène à la conclusion de ma conférence qui sera de vous montrer quelques uns des immenses avantages que la religion apporte à la poésie. Je ne dis pas que tout bon catholique soit aussi un bon poète. Parce que le talent poétique, l’inspiration poétique est, comme la prophétie, une grâce, une grâce gratuite, ce que les théologiens appellent « gratia gratis data ». Mais je veux dire que le poète catholique a sur ses frères un immense avantage.
Parmi les secours et les profits que la Religion apporte à la poésie j’en indiquerai trois. Le premier est que la foi en Dieu permet la louange. La louange est peut-être le plus grand moteur de la poésie, parce qu’elle est l’expression du besoin le plus profond de l’âme, la voix de la joie et de la vie, le devoir de toute la création, celui en qui chaque créature a besoin de toutes les autres. La grande poésie depuis les hymnes védiques jusqu’au Cantique du Soleil de saint François est une louange. La louange est par excellence le thème qui compose. Personne ne chante seul. Même les étoiles du Ciel, lisons-nous dans les Livres Saints, chantent ensemble
La Religion non seulement nous rapporte le chant, elle nous apporte aussi la parole. La Religion – la religion Chrétienne, la religion Catholique, c’est tout un pour moi – a apporté dans le Monde non seulement la joie mais aussi le sens. Puisque nous savons que le monde n’est pas l’ouvrage du Hasard ou de forces naturelles aveugles et se cherchant à tâtons, nous savons qu’il y a un sens. Il nous parle de son créateur, il nous donne les moyens de comprendre son œuvre ou en tous cas de l’interroger et de lui payer nos dettes. Il nous conduit vers Lui par beaucoup de voies merveilleuses. Il nous donne les moyens de demander et de répondre, d’apprendre et d’enseigner, de faire du bien à nos frères et d’en recevoir d’eux. Vous voyez partout des sceptiques et des agnostiques qui, comme des gens à moitié idiots, sont incapables de répondre aux questions morales ou intellectuelles les plus simples. Un catholique connaît ce qui est blanc et ce qui est noir, à chaque question il est capable de répondre par oui ou par non, un oui très clair et un non très sonore. Toutes ces choses sont inestimables pour un poète et pour un artiste parce que le scepticisme, le doute, l’hésitation, est justement le chancre mortel de Part véritable.
Le troisième avantage que nous apporte la Religion est le Drame. Dans un monde où vous ne connaissez le oui et le non de rien, où il n’y a pas de loi, morale ni intellectuelle, où toute chose est permise, où il n’y a pas de loi, morale ni intellectuelle, où toute chose est permise, où il n’y a rien à espérer et rien à perdre, où le mal n’apporte pas de punition et le bien pas de récompense, dans un tel monde il n’y a pas de drame parce qu’il n’y a pas de lutte et il n’y a pas de lutte parce qu’il n’y a rien qui en vaille la peine.
Mais avec la Révélation Chrétienne, avec les immenses et énormes idées du Ciel et de l’Enfer qui sont autant au-dessus de notre compréhension que le ciel étoile est au-dessus de nos têtes, les actions humaines, la destinée humaine, sont investies d’une valeur prodigieuse. Nous sommes capables de faire un bien infini et un mal infini. Nous avons à trouver notre Route, conduite ou égarée, comme des héros d’Homère, par des amis ou des ennemis invisibles, parmi les vicissitudes les plus passionnantes et les plus imprévues, vers des sommets de lumière ou des abîmes de misère. Nous sommes comme les acteurs d’un drame très intéressant écrit par un auteur infiniment sage et bon où nous tenons un rôle essentiel, mais où il nous est impossible de connaître d’avance la moindre péripétie. Pour nous la vie est toujours nouvelle et toujours intéressante parce qu’à chaque seconde nous avons quelque chose de nouveau à apprendre et quelque chose de nécessaire à accomplir. Le dernier acte, comme dit Pascal, est toujours sanglant, mais aussi il est toujours magnifique, car la Religion n’a pas seulement mis le Drame dans la vie, elle a mis à son terme, dans la Mort, la forme la plus haute du drame, qui, pour tout vrai disciple de notre Divin Maître, est le Sacrifice.
«El arte moderno y los católicos» (Manuel Abril)
Georges Roault: «Payaso», 1912
Manuel Abril: “El arte moderno y los católicos” (1928)
(La Gaceta Literaria, 1/4/1928, nº 31, p. 6)
En este mismo lugar y en otros varios hemos venido subrayando un hecho que parece a primera vista extraño, pero que tiene, en rigor, una explicación natural y significativa. El hecho de que las tendencias más avanzadas de arte plástico –cubismo e oltre, que dijo Soffici en su día– encuentren sus defensores más tenaces, y al mismo tiempo más firmes, entre los publicistas católicos.
Parece extraño el caso, porque propendemos a dar por supuesto que un católico ha de anteponer a todo su concepto religioso, y que su concepto religioso ha de ser moral ante todo. Un católico –pensamos– es un hombre que tiene en la vida, o por encima de la vida, una razón superior de índole moral y ultraterrena. Todo importa poco para el religioso ante el único objetivo importante de esta vida: salvar su alma en la otra. El catolicismo recomienda para ello el ascetismo, tiene al mundo como al enemigo del alma, presenta como vidas ejemplares una cantidad de santos que no se preocuparon del arte para nada y que no tuvieron en cuenta más norma de belleza que la espiritual. Parece que el católico,c aso de que se preocupara del arte, habría de inclinarse a un arte apto para imbuir en las almas las grandes emociones y las elevadas lecciones de índole espiritual que su religión contiene. Bueno dedicarse al arte, pero, de dedicarse a él, tomarlo como instrumento, a fin de hacer patente, como sólo el artista puede hacerlo, la infinita emoción de los pasajes sagrados de la historia, a fin de hacer comunicativa ya, por ejemplo, la irresistible atracción de la pureza de la Virgen, ya la noble y conmovedora humildad de la Sagrada Familia, o el espectáculo infinitamente desgarrador y arrebatador de un Jesús crucificado. Nada mejor que el arte —que la pintura especialmente— puede hacer sentir a los demás este género de grandezas inefables. Y como el catolicismo se nutre de ellas y de ellas se compone parece natural que los católicos defendieran este género de arte, tan eficaz para la divulgación, y rechazaran en cambio, y al mismo tiempo, el otro, y no sólo por una razón, sino por varias: una, porque siendo irrepresentativo no divulga nada, y otra, porque, además, pudiera parecerles un cargo de conciencia que un artista pierda en ese arte el tiempo y el talento, preciosos, que pudiera dedicar a las eficacias del otro.
Los hechos, sin embargo, van contra esa lógica aparente. Los artistas católicos son los que mejor han defendido —y a veces practicado— ese arte que se nos aparece como un mero esteticismo, como un puro divertissement estético, sin contenido formulado; mero deleite de arte que ni enaltece, ni glosa, ni divulga las glorias superiores del alma y de la mística. Esto parece extraordinario y, sin embargo, entraña una profunda, una sabrosísima lección.
El hombre es inacabable. Cada facultad está en él para contribuir con su intervención a la unidad del concertante universal. Llevan a Roma y al cielo muchos más caminos de los que puede imaginar nuestra humana sabiduría.
Sin embargo, la explicación de este camino es, en este caso, para nuestra modesta sabiduría, facilísimo.
Hay en el mundo, a disposición del hombre, dos o tres únicas ocasiones de patentizar la realidad, la autenticidad, la existencia substantiva de eso que llamamos “espíritu”, y una de esas raras ocasiones nos la ofrece el arte; y nos la ofrece, mejor que otro cualquiera, “ese” arte, el arte que llaman puro, el irrepresentativo.
Allí donde hay arte, hay espiritualidad, según nosotros; la obra de arte lo es en tanto en cuanto espíritu; pero con las obras representativas ocurre que, si bien pueden, como todas, patentizar, en tanto en cuanto artísticas, la existencia del espíritu, llevan mezclada, sin embargo, en tanto en cuanto representación, una ganga de elemento confesionario, ajeno, de materialismo, de naturalismo, y parece que no son esos elementos los que contribuyen a la formación del arte, perjudicando, en consecuencia, y enturbiando la intervención decisiva y exclusiva que tiene en el coro artístico el fenómeno espiritual.
“Espíritu” y “espiritual” quieren decir aquí lo que no puede ser entendido como análogo ni como derivación de lo que entendemos por “materia” o de lo que entendemos —si se quiere— por “física”, “biología” o “naturaleza”, etcétera. Consideremos un objeto cualquiera posible —mental, o físico, o natural—; tratemos de ver, examinando sus elementos componentes uno a uno, si alguno de ellos, o alguna parte de ellos, no procede de la naturaleza ni puede hallar cabida en el concepto “materia”. Si encontramos algo así, algo que se nos aparezca como anterior a la materia y a la naturaleza, como independiente de ella y como condicionando —digamos— a lo material y natural, en vez de estar, a la inversa, condicionado por ello; si hallamos algo así, “eso” —que será activo en vez de inerte; en vez de actuado, agente; en vez de efecto, causa, que será, por lo tanto, original, de origen y no de consecuencia— deberá recibir otro nombre, otro apelativo que el de material; deberá llamarse “espiritual”, por ser ese el nombre que recibe la única dimensión o categoría concebible como opuesta a la materia.
Esto es precisamente lo que puede, mejor que en parte alguna, encontrarse en el arte puro. El arte puro dice:
Hay, entre los elementos sensibles, facultad de formar entre sí grupos de tal naturaleza que, allí donde se dan, dan por efecto en el espíritu del hombre una emoción deleitable, peculiar. Esa emoción es primaria, elemental, original; procede de la relación de los elementos entre sí, no de su agrupación representativa; procede de una proporción de masas, líneas, pesos, calidades y cadencias, ya sean de orden musical, ya de orden plástico. El arte es eso. El arte vive de las leyes de la armonía, y estas leyes son anteriores a toda forma o figura representativa. Es la armonía lo que justifica la belleza de las figuras naturales, y no al revés: no son las figuras naturales las que hacen posible la belleza.
Para demostrar esto habría dos caminos. Uno —insinuado ya por nosotros otras veces—, el de batir ver que la arquitectura y la música son artes y lo han sido siempre, sin que hayan necesitado para serlo ser imitativas. Otro, el de hacer ver que el concepto mismo de arte imitativo no tiene consistencia y no tiene ni sentido.
En la naturaleza, en efecto, hay belleza, pero no todo es bello en la naturaleza; luego no puede decirse que lo bello es lo natural; que sólo por ser natural sea bella una forma. Se ha dicho que todo en la naturaleza puede ser motivo de belleza o de arte cuando el artista sabe interpretarlo. Se ha dicho que el arte es la naturaleza a través de un temperamento. Se han dicho muchas cosas de esta clase.
Pero nada de esto va en favor de la naturaleza, sino que va precisamente en su contra. Si el arte depende —como efectivamente depende— del temperamento del artista o de la interpretación que el artista puede darle, ya no depende de la naturaleza. La naturaleza sería, en estos casos, el instrumento, el material, el arsenal de selección o el cañamazo —como quiera decirse— para que el artista instrumente a su antojo una fantasía particular. Pero ni aun así podría servir todo ello, en absoluto, para explicar los hechos que la historia del arte nos ofrece. Un aria de Bach no es naturaleza interpretada; ni el Partenón ni la catedral de Colonia son naturaleza interpretada.
Si decimos “lo bello es lo natural”, no podremos explicarnos ni por qué puede haber entre dos formas naturales una que nos parezca mejor, más bella o más artística que otra —pues teniendo ambas igual naturaleza debieran ser iguales en belleza—, ni podremos explicarnos por qué puede ser bello lo que no sea natural.
En cambio, si decimos “hay unas leyes en el mundo independientes y anteriores a cualquier forma inventada o a cualquier forma natural; unas leyes que afectan a las masas, a las líneas, a los colores o a las cualidades; a los elementos plásticos sensibles de los cuerpos, y allí donde esas leyes se dan, allí se da la belleza”, entonces nos explicaremos tanto el arte en la naturaleza como el arte en lo no natural.
Si esas leyes existen, en afecto, y el hombre combina unos cuantos elementos sensibles con arreglo a ellas, la combinación que resulte será una forma artística, aunque no se parezca en nada a ninguna otra forma conocida. Y tendremos con ello explicado el arte de lo no natural. Si la naturaleza al crear formas orgánicas las crea por cualquier motivo y por añadidura con arreglo a las leyes de la agrupación artística, aquellas formas orgánicas serán, además de orgánicas, bellas. Pero si la naturaliza crea cualquier otra forma cuya organización biológica no coincide con las leyes de la organización estética, aquella forma natural no será bella, por naturalísima que sea.
Sólo así puede tener sentido además el concepto de originalidad, y sólo así el de creación —dentro de lo humano, relativamente—, y sólo así el de fantasía.
Siendo ciertas estas leyes, y teniendo carácter de a priori, de anteriores a todo lo que constituye la esencia ideal de lo material y de lo natural, se evidencia con ellas el principio espiritual que las sostiene y las informa.
Sólo en esas leyes y por esas leyes puede el hombre encontrar un ejemplo en donde se patentiza la ley más íntima del ser: la unidad en la armonía. Espiritualidad, imperfecta si se quiere, porque necesita residir, apoyarse, partir de lo sensible, pero emancipada de la materialidad en cuanto unidad y armonía; elemento participante del principio espiritual, pura esencia y principio de la armonía en la unidad, que es el principio que explica o constituye lo mismo el arte, que la bondad, que la caridad, que el amor sumo, que la plenitud de la esencia divina.
Arte que no comprenda de este modo la belleza, sería, en sus fundamentos, pagano: necesitaría de la naturaleza y de la materia para referir a ellos todo lo maravilloso. Será pagana —y escéptico en lo que se refiere a la esencia espiritual—, puesto que para explicarse la belleza recurre a lo natural, como si no existiera el espíritu, como si fuera necesario recurrir a la Natura para justificar toda grandeza. Para ellos la Natura, la diosa Natura, es la que crea, la que lo origina todo y la que todo, en última razón, lo justifica.
El católico cree que eso no es cierto, y como lo cree, acepta sin dificultad el arte por el arte, que es, dicho de otro modo, el arte por el espíritu; y lo acepta, primero, por amor a la verdad, y segundo, porque esa verdad constituye uno de sus mejores argumentos en pro de la existencia del orden espiritual como regulador del universo.
* * * * *
Estas son las principales ocurrencias que se me presentan al pensar en la relación actual del catolicismo y el arte. No basta, por supuesto, con lo dicho, no ya para demostrar —que no hemos aspirado nosotros a tanto—, para situar tan sólo hay que establecer otras varias relaciones, pues estas cuestiones se enlazan unas con otras, y sólo después de recorridas todas ellas se presenta el asunto en su verdadera situación.
Esto indica que la campaña ideológica iniciada hoy por La Gaceta Literaria no debe quedar en mera manifestación circunstancial de grupo recogido de pronto, un día cualquiera, para ser presentado como número de atracción periodística, sino que debe ser algo persistente, capaz de presentar a la opinión todo el punto de vista de la inteligencia católica frente a los problemas actuales del arte y del pensamiento.
«Le Roman catholique» (Thibaudet)
Ejemplar de la Nouvelle Revue Française que contenía el artículo
Albert Thibaudet: «Le Roman catholique» (1926)
(Nouvelle Revue Française, nº 153, junio de 1926, pp. 727-734. Selección de fragmentos)
Sous le Soleil de Satan, de M. Bernanos, a obtenu une considération méritée. C’est un admirable début. De grands esprits, parmi lesquels Dante, ont attribué au diable l’invention des romans. M. Bernanos me fait songer à un mouvement stratégique des romanciers catholiques pour attraper le Malin et l’obliger d’entrer dans la bouteille où il nous servait son vin empoisonné.
* * * * *
Pour diverse raisons, parmi lesquelles il faut compter l’importance du public catholique, qui lit beaucoup, le titre de romancier catholique est brigué par un certain nombre d’auteurs.
Il y a d’abord les catholiques d’éducation, qui pensent reconnaître, et qu’on reconnaîtra dans leur œuvre, ce qu’on appelle, d’un terme (barrésien) à équivoque, la sensibilité catholique. La sensibilité catholique expliquerait en partie les romans de M. François Mauriac. Il est possible qu’il y ait quelque chose de cela, surtout dans ses premiers livres. Mais dans ses œuvres de la période des Cahiers Verts je vois des cas psychologiques ou humains, qui pourraient aussi bien se rencontrer dans des familles protestantes ou maçonniques. M. de Montherlant tenait, luis aussi, fortement, à la catholicité de ses ouvrages ! […]
Mais précisément on songe alors à une troisième sorte de roman et de romanciers catholiques qui auraient pour sujet non pas, comme les premiers, les survivances de la vie catholique dans la vie qui ne l’est plus [Mauriac, Montherland] ; non pas, comme les seconds, la défense et l’illustration de l’ordre catholique [Paul Bourget] ; mais la vie catholique elle-même, vécue de l’intérieur, sentie dans se exigences et ses profondeurs. On a pu trouver quelque chose de ces intentions dans les romans de M. Emile Baumann. Les drames chrétiens de Claudel impliquent ce foyer à leur centre. Le roman de M. Bernanos est bien un roman de cette vie religieuse profonde, ou du moins il l’est en partie et nous fait croire que les prochains suivront cette filière, où d’ailleurs les difficultés ne manquent pas. Mais ce qu’on entend par littérature ce sont des difficultés qu’on a tournées, que la vie a tournées.
Il est d’abord à croire que, dans les conditions actuelles de la littérature catholique, ce soit plutôt au roman catholique qu’au roman simplement chrétien qu’on doive s’attacher.
C’est en somme avec Stendhal (un précurseur envers qui M. Vautel est bien ingrat) que la psychologie de la vie cléricale est entrée dans le courant littéraire. Il y avait fallu la Révolution, la Concordat et la Chartre. Seulement cette psychologie ne va pas très loin. Elle concerne l’automatisme du métier plutôt que sa source d’énergie. La substance de la vie catholique consiste dans l’usage des sacrements. On est catholique dans la mesure où l’on mène une vie spirituelle rythmée et nourrie par les sacrements. […] Un roman qui ne fait pas de place à la vie par les sacrements, pourra-t-on l’appeler catholique ?
L’existence, l’avenir du roman catholique en France paraissent liés à une situation assez paradoxale de notre littérature religieuse : l’effacement croissant du clerc devant le laïque. […] En France, la France de Montaigne et de Voltaire, l’œuvre la plus urgente que pût se proposer le clergé était la défense de la religion contre la libre-pensée. En effet, trois grandes Apologies du christianisme ont enrichi notre littérature, […] mais d’eux d’entre elles, celle de Pascal et celle de Chateaubriand, sont écrites par des laïques, par des individualités sans mandat, et l’auteur de la troisième, Lamennais, ne demeure prêtre que provisoirement. […] En dehors du XVIIe siècle, pas de littérature cléricale qui compte.
Littérairement aussi l’Eglise ne court pas. Mais Pascal, inventeur des omnibus, a créé avec les Petites Lettres une littérature qui court. Et la phrase de Voltaire, elle court, elle court. Ce mot d’une encyclique de Grégoire XVI, comme il est plein d’expérience sacerdotale : haec detestabilis atque exsecranda libertas artis librarie !
Mais il s’agit là seulement du prêtre. Les catholiques laïques peuvent courir sous l’orage, et même à une vitesse de onze devant la porte dorée. Les journalistes catholiques valent les autres. […] Le roman, pour l’Église, a été longtemps, lui aussi, detestabilis atque exsecrandus. Elle a confirmé le verdict de Dante qui l’a, avec Françoise de Rimini, placé dans l’enfer. […] Cette année où j’écris, le roman catholique, la littérature catholique, semblent prendre une place privilégiée, à la suite d’un mouvement qui a commencé, je crois, avec la querelle du Jardin sur l’Oronte.
La place accordée aujourd’hui dans les lettres aux sentiments et aux problèmes religieux, elle a été conquise en partie sur la politique. Il n’y a plus, mais plus du tout, de littérature politique. […] On pourrait parler plus tard d’une « école du Roseau », ou d’un mouvement du Roseau [d’Or]».
José Bergamín: la política, el arte y el catolicismo
José Bergamín
José Bergamín: “Ni arte ni parte”
(La Gaceta Literaria, 1/4/1928, nº 31, p. 1)
Por todas partes se va a Roma. Por eso, los que piensan ir, se dicen a sí mismos: vayamos por partes. Y los que se llaman a la parte, a las partes –a todas y a cualquiera–, se convierten en partes también, y son las partes, los actores, los de la derecha y la izquierda, según la mano, que es por lo que se pierde o se gana: por la mano, l mano de jugar. Porque es juego de mano, en efecto, eso de la derecha o la izquierda, juego de villanos: de villanía, de ciudadanía, de ordenanza municipal: llevar la derecha o la izquierda. Ahora se lleva más la derecha, según parece. Según parece y puede que no sea; que no todo sea por Dios. Y por Dios tiene que serlo todo y no parte ni arte ninguno. Que todo sea por Dios, aunque no lo parezca, es cosa natural. Que no lo sea, que lo parezca, artificial, del Diablo, por el Diablo. Naturalmente, un contra-Dios. Y Dios no puede tener partido, ni arte servicial. Arte, ¿de qué? Porque el arte por el arte no es nada, y el arte para el arte, menos que nada: una diablura, una manera engañosa y aparente de pordiosear. Y también por la mano, por las manos, villanamente, en un doble juego de hipócrita ignorancia mutua para dar y tomar. Que hay quien se cree seguro, porque ignora hasta dónde tiene su mano derecha, y quien se cree inocentemente responsable –en arte y en parte– sencillamente porque se ha lavado las manos, cuidadosamente, por higiénica habitualidad. Y no basta. Que el hábito de religiosidad no hace desaparecer en el monje o fraile post-artístico el que haya sido antes cocinero. Artífice, más o menos puro, o limpio (por mucho que se lave las manos) de cualquier recetario estético pseudorreligioso espiritual. Que si hay quienes toman un dogma católico por una receta, hay más aún que toman cualquier receta –estética, científica, política o moral– por dogma, y católico, de transcendencia universal. Y quieren colocarnos a nosotros, los que somos dogmáticos católicos, gracias a Dios, de un modo policíaco y escénico, callejero o teatral: a modo –y a modas– de los otros, de los de la mano, de los actores o histriones, de los de la farsa (la farsa, con todos los respetos: lo más respetable en el teatro no es el público, sino el farsante), de los de la derecha o la izquierda, en fin.
Pero el camino real de Roma –catolicismo–, que es el único camino real, es ruta celeste y no tiene derecha ni izquierda determinada por una exigua economía espacial. Las relaciones son distantes, siderales, de proporciones astronómicas. ¿Derecha o izquierda de qué?, cuando estamos, no en parte –ni en arte– sino en todo, en el Universo –catolicismo–, en la Iglesia (natural y sobrenatural, visible e invisible), católica, apostólica, romana: en la universalidad. Yo, que soy católico de nacimiento, como todo el mundo –católico de nacimiento, como es natural, y de re-nacimiento, como es sobrenatural–, no conozco, naturalmente –ni sobrenaturalmente– ninguna otra universalidad.
Pero es que los que no tienen religión ninguna –positiva, dogmática– se han hecho religión de todo; del arte (¿y qué es eso: el arte?), de las artes –poéticas (música, pintura, literatura…)– también. Y también de la moral o de la política, o de la ciencia, y hasta de sus caprichos. Idolos bellos o feos, según. Supersticiosa autoridad. Se han hecho –hecho y no engendrado– su fe, instintiva, turbia, fatal, sin entenderla. Y es que han puesto su fe en el hecho, en lo hecho, y en el arte, cualquier arte, es siempre un hecho, un artefacto –como decían los escolásticos–, una construcción, o arquitectura, poética, espiritual. No una creación divina, sino una criatura humana, de la que el poeta es responsable en conciencia –en su conciencia–, pero de la que es, integralmente, totalmente, independiente. Por eso, si quiere, le somete, o se somete a una autoridad. Y la única, sola, exclusiva y excluyente autoridad viva para un católico es la de su Iglesia. No en arte ni en parte, sino en todo.